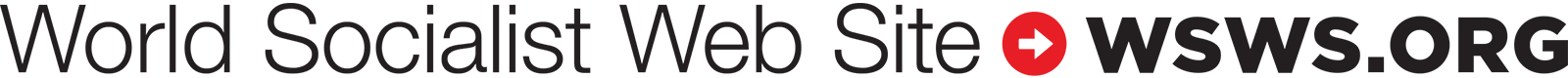L’axe de ma conférence aujourd’hui, « La Guerre et la Révolution : 1914-1917 », est une remarque très importante faite par David North en lançant cette série de conférences. La septième de ses dix raisons pour lesquelles il faut étudier la Révolution russe, était la suivante :
La révolution russe mérite d’être étudiée en tant qu’étape critique du développement de la pensée sociale scientifique. La victoire historique des bolchéviks en 1917 a démontré et réalisé la relation essentielle entre la philosophie matérialiste scientifique et la pratique révolutionnaire.
Cette approche est vitale pour trois raisons interdépendantes :
D’abord, l’approche matérialiste est la clé pour comprendre la nature de la Première Guerre mondiale, ses origines, ses causes sous-jacentes, ainsi que sa profonde signification à notre époque.
Deuxièmement, elle nous permet d’identifier les causes objectives de la Révolution russe, qui est née des mêmes transformations du capitalisme mondial qui ont produit la guerre.
Troisièmement, elle nous permet de saisir le contenu essentiel de la stratégie révolutionnaire développée surtout par Lénine, qui a abouti à la conquête du pouvoir par la classe ouvrière sous la direction des bolchéviks en novembre 1917.
Ces remarques, qui sont faites ici sous une forme quelque peu abstraite, deviendront, je l’espère, plus claires à mesure que nous suivrons le cours des événements et l’analyse politique de Lénine.
Les causes objectives de la Première guerre mondiale
Penchons-nous maintenant sur la question de la Première Guerre mondiale elle-même. Plus de cent ans après l’éruption de la guerre, en août 1914, la question de ses origines demeure controversée. C’est parce que cette question est directement reliée à l’analyse des événements contemporains.
Il y a, en gros, deux positions opposées : celle du marxisme, et celle des diverses écoles de la recherche libérale bourgeoise.
L’analyse marxiste, si on la présente dans ses grandes lignes, est que la guerre était le résultat de conflits issus de la contradiction objective et irréconciliable du mode de production capitaliste : celle entre le caractère mondial de l’économie et le système des États-nations dans lequel est ancré le système de profit.
Les théories opposées se ramènent à la conception que la guerre était le résultat d’erreurs politiques, de faux calculs ou de mauvais jugements de divers politiciens bourgeois, et qu’elle aurait pu être évitée si la sagesse avait eu le dernier mot.
Des questions politiques se rattachent directement à ces analyses opposées. Si l’analyse marxiste est juste, il est clair qu’on ne peut mettre un terme à la guerre et à la menace d’une destruction de masse sans mettre un terme au système de profit et des États-nations, et sans créer un nouvel ordre économique et social.
C’est pourquoi, après les quatre années de guerre, les politiciens bourgeois qui avaient présidé à la plus grande boucherie de l’histoire humaine, ont tenté dès le départ de se décharger, eux-mêmes et le système capitaliste, de toute responsabilité. Selon le Premier ministre britannique du temps de guerre, Lloyd George, la guerre a éclaté de manière presque accidentelle. C’est une chose sur laquelle les grandes puissances ont « glissé, ou plutôt chancelé et trébuché ». Les nations ont « glissé au bord du précipice et sont tombées dans le chaudron de la guerre ». [1]
Les historiens bourgeois ont suivi la voie des politiciens bourgeois, ne ménageant aucun effort pour réfuter l’analyse marxiste de la guerre comme étant l’éruption violente des contradictions du système capitaliste. Selon l’historien britannique Niall Ferguson, par exemple, il n’y a aucune preuve que les hommes d’affaires souhaitaient la guerre; en fait, ses conséquences les effrayaient. Donc, insiste-t-il, « l’interprétation marxiste des origines de la guerre peut être jetée aux oubliettes de l’histoire, avec la plupart des régimes qui l’ont entretenue » [2]. On pourrait répondre qu’aucun homme d’affaires ne souhaite les récessions et les crises économiques, mais elles arrivent tout de même.
Si ce n’était que le résultat d’erreurs et de faux calculs, pourquoi, deux décennies seulement après « la guerre pour mettre fin à toutes les guerres », une catastrophe encore plus importante, la Deuxième Guerre mondiale, a-t-elle éclaté en 1939? Et pourquoi la situation actuelle ressemble-t-elle autant à celle qui a produit les deux guerres mondiales : d’innombrables poudrières, en Europe de l’Est, dans la Mer de Chine méridionale, en Corée, au Moyen-Orient, pour n’en nommer que quelques-unes, et des tensions croissantes entre les grandes puissances capitalistes?
L’analyse marxiste de la guerre est en accord avec le dicton mis de l’avant par le théoricien allemand Clausewitz au dix-neuvième siècle : la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens.
Quelles étaient donc les relations politiques qui existaient au cours de la période menant à l’éruption de la Première Guerre mondiale?
Celles-ci ne peuvent être comprises que par une analyse scientifique, c’est-à-dire matérialiste, qui situe les relations politiques dans le développement de l’économie capitaliste.
Évidemment, les politiciens capitalistes prennent des décisions, y compris celle de faire la guerre. Il n’existe aucune loi économique qui dit que la guerre doit éclater tel ou tel jour.
Mais leurs décisions sont façonnées par le cadre politique et économique dans lequel ils cherchent à défendre les intérêts des État-nations capitalistes qu’ils dirigent. À un certain point, aussi désirable ou même indésirable qu’elle puisse être, la décision d’aller en guerre devient la moins pire des options qui s’offrent à eux.
Dans une perspective très large, la période menant à l’éruption de la Première Guerre mondiale se divise en deux époques distinctes.
La grande révolution française de 1789-93 a ouvert une nouvelle ère historique : le renversement des régimes féodaux obsolètes frayait la voie au développement des États-nations capitalistes.
La période de 1789 à 1871 a vu l’établissement, à travers une série de guerres nationales et de révolutions, du cadre moderne des États-nations, culminant avec la fondation de l’État national allemand par Bismarck à la fin de la guerre franco-prussienne.
Avec la guerre civile américaine, qui s’est terminée par la victoire du nord industriel, ces États nationaux ont servi de puissants catalyseurs au développement des forces productives sous le capitalisme. Toutefois, ce processus même a fait naître une nouvelle époque.
Le dernier quart du dix-neuvième siècle et la première décennie du vingtième siècle ont vu non pas des guerres nationales contre les vestiges de l’absolutisme féodal mais des luttes des grandes puissances pour obtenir des colonies. L’Afrique, par exemple, n’avait pratiquement pas été colonisée en 1875. Vingt-cinq ans plus tard, cependant, elle était presque entièrement découpée par la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et la Belgique.
L’évolution économique avait transformé la structure politique du monde. Pendant la première moitié du dix-neuvième siècle, la Grande-Bretagne avait été la puissance capitaliste dominante. Elle était l’atelier du monde et sa marine régnait sur les océans.
Mais de nouveaux rivaux émergeaient. Sur le continent européen, l’Allemagne s’industrialisait massivement. À l’Est, il y avait le Japon. Et à l’Ouest, les États-Unis avaient fait leur entrée dans la lutte pour les colonies avec la guerre hispano-américaine de 1898 et l’annexion et subjugation ultérieures des Philippines.
Chacune de ces puissances capitalistes voulait, pour emprunter l’expression allemande, faire « sa place au soleil ». Mais ce faisant, elles étaient toutes confrontées les unes aux autres.
Une fois, un diplomate allemand demanda à son confrère britannique à quel endroit le gouvernement de Sa Majesté ne s’opposerait pas à l’établissement de colonies allemandes. Le diplomate britannique répondit que Whitehall n’avait aucune objection à la construction de colonies allemandes, à condition qu’elles ne soient pas contigües ou situées entre deux colonies britanniques. Autrement dit « nulle part », répliqua le diplomate allemand.
Les tensions entre les grandes puissances capitalistes montaient. La Grande-Bretagne et la France s’étaient presque livré la guerre lors de l’incident de Fachoda en 1898 lorsque leurs forces armées se firent face dans le Haut-Nil.
Un conflit a éclaté lorsque l’empereur allemand exprima son soutien pour les Boers en Afrique du Sud. Les Balkans, sous le contrôle de l’empire austro-hongrois, devenaient une poudrière marquée par l’opposition nationale à la domination autrichienne, un conflit touchant directement la Russie qui cherchait alors à effectuer une percée vers l’Ouest pour défendre ses intérêts.
Dans les ministères et les chancelleries, on évaluait ce que réservait cette nouvelle période.
En 1907, un sous-secrétaire du ministère britannique des Affaires étrangères, Eyre Crowe, a écrit un mémorandum détaillé pour le secrétaire des Affaires étrangères, Lord Grey. Crowe était chargé d’évaluer si, vu la croissance de l’économie et de l’influence allemandes, les intentions de Berlin étaient pacifiques ou non.
Il a conclu qu’en fin du compte, cela importait peu, car le développement même de l’Allemagne et de ses intérêts mondiaux menaçait l’empire britannique. Ainsi, quelle que soit l’évaluation faite des intentions de l’Allemagne, la Grande-Bretagne devait se préparer à la guerre. Celle-ci éclata seulement sept ans plus tard.
L’événement immédiat qui a déclenché la Grande Guerre de 1914, l’assassinat de l’archiduc autrichien Ferdinand par un nationaliste serbe à Sarajevo en Bosnie le 28 juin, pourrait être qualifié d’accident. Ce qui s’ensuivit ne l’était pas.
Le régime autrichien craignait le morcellement de son empire en Europe centrale et du Sud-est. Il voulait à tout prix écraser l’opposition nationaliste naissante dans les Balkans, menée par la Serbie et soutenue par une menace encore plus importante : la Russie. Il formula des demandes impossibles à la Serbie suite à l’assassinat, afin de provoquer une guerre.
La guerre aurait pu se limiter à une escarmouche locale si la situation autrichienne n’avait pas été si étroitement liée aux intérêts économiques et stratégiques de toutes les grandes puissances européennes.
À Berlin, la monarchie Hohenzollern a émis à son allié autrichien ce qui revenait à un « chèque en blanc » pour toute action nécessaire contre la Serbie, même si cela menait à une guerre avec la Russie. Selon une déclaration officielle allemande, si l’on permettait aux Serbes, soutenus par la Russie et la France, de continuer à menacer la stabilité de la monarchie autrichienne, cela affaiblirait la position de l’Allemagne. Des intérêts économiques vitaux étaient également en jeu.
Faisant un retour en 1917 sur ces événements, le politicien allemand Gustav Stresemann a résumé la perspective des cercles industriels qu’il représentait. L’Allemagne a vu « les autres conquérir des mondes », un monde « sous le sceptre des autres » où « notre souffle de vie économique » était de plus en plus étouffé. [3]
Des questions non moins vitales étaient en jeu pour la France, qui soutenait la Russie contre l’Allemagne. L’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne en 1871 avait entraîné, comme Marx l’avait prédit, une alliance entre la France et la Russie dans laquelle les deux s’armaient contre l’Allemagne.
Dans le conflit entre l’Allemagne et la Russie, la France ne pouvait pas rester neutre car toute rupture de l’alliance développée sur un quart de siècle, comme allait l’expliquer plus tard le président français Poincaré, « aurait laissé la France isolée et à la merci de ses rivaux » [4].
La Grande-Bretagne était également confrontée à des problèmes économiques et stratégiques vitaux. Elle voulait maintenir l’équilibre des forces en Europe, afin de s’assurer qu’aucune autre puissance ou groupe de pays ne puissent contester son hégémonie mondiale, laquelle était fondée sur son empire, et surtout le pillage de l’Inde.
Dans une remarque d’une franchise remarquable, le premier lord de l’amirauté, Winston Chruchill, résuma la position britannique lors d’un débat en 1913-14 sur les dépenses navales :
Nous avons tout le territoire que nous pourrions vouloir, et notre prétention à jouir sereinement de nos vastes et splendides possessions, acquises surtout par la violence et préservées par la force, paraît souvent moins raisonnable aux autres qu’à nous. [5]
Donc, après quelques atermoiements, la Grande-Bretagne décida de soutenir la France et entra en la guerre contre l’Allemagne.
Les dirigeants politiques n’avouaient jamais les véritables objectifs de la guerre, évidemment. Comment un gouvernement peut-il dire à sa population qu’il envoie la fleur de sa jeunesse se faire tuer et estropier sur les champs de bataille au nom du profit et de l’acquisition de ressources, de colonies et de marchés? Les grandes puissances tentèrent de dissimuler les vrais enjeux derrière une série de mensonges sans fin dans les médias de masse.
En Allemagne, on proclamait que la guerre visait à « défendre la patrie » afin de préserver la culture et l’économie allemandes contre la barbarie russe.
La France affirmait qu’elle partait en guerre afin de défendre les idéaux de la vie politique française, l’héritage de la Révolution française, la liberté et l’égalité, contre l’autocratie prussienne, nonobstant le fait qu’elle s’alliait au régime despotique du tsar.
La Grande-Bretagne affirmait qu’elle entrait en guerre pour défendre la neutralité de la « petite Belgique » si grossièrement violée par les « Huns », même si elle aurait fait de même.
Et lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en avril 1917 dans le but de défendre leurs propres intérêts stratégiques et financiers, ils ajoutèrent à cette montagne de mensonges en déclarant que la guerre visait « à garantir la démocratie dans le monde ».
La trahison de la Deuxième Internationale
Le mouvement marxiste ne fut pas pris de court par l’éruption de la guerre. En fait, Frederick Engels l’avait prédite dès 1887. La seule guerre qui restait à être menée par la Prusse-Allemagne, écrivait-il, serait une guerre mondiale, dont la violence serait d’une ampleur jusqu’ici inconnue.
Huit à dix millions de soldats se combattraient et ainsi dépouilleraient l’Europe plus que ne le ferait un nuage de sauterelles. Les déprédations causées par la guerre de Trente ans concentrées en trois à quatre ans et étalées sur tout le continent : la famine, les maladies, la chute universelle dans le barbarisme, tant pour les armées que pour la population. La misère entraînerait la dislocation irréparable de notre système commercial, industriel et de crédit artificiel, aboutissant en l’effondrement universel des vieux États et de leur sagesse politique conventionnelle à un point où les têtes couronnées rouleraient dans les caniveaux par dizaines.
Il était impossible de prédire comment la guerre se terminerait et qui l’emporterait, poursuivait-il. « Une seule conséquence est absolument certaine : l’épuisement universel et la création des conditions pour la victoire ultime de la classe ouvrière. » [6]
La Deuxième Internationale, composée des partis sociaux-démocrates se réclamant du marxisme, avait analysé la montée des rivalités entre les grandes puissances et averti du danger de guerre qui émergeait de la lutte pour le partager des marchés et des profits.
Mais si l’éruption de la guerre elle-même ne fut pas une surprise, la réaction des partis dirigeants de l’Internationale, elle, fut un véritable choc.
Le 4 août 1914, alors que l’armée allemande marchait sur la Belgique pour conquérir la France, les représentants parlementaires du SPD allemand, le parti dirigeant de l’Internationale, votaient à l’unanimité en faveur des crédits de guerre. Quatorze des quatre-vingt-douze députés y étaient opposés, mais ils se sont soumis à la discipline de parti lors du vote au Reichstag. Les socialistes français firent de même, déclarant leur soutien à leur propre pays.
Ces décisions violaient les résolutions adoptées aux congrès de la Deuxième Internationale. En 1907, lors d’un congrès tenu à Stuttgart, en Allemagne, l’Internationale avait adopté une résolution affirmant que les partis de l’Internationale devaient « mettre tout en œuvre » pour empêcher la guerre, et ce, par tous les moyens jugés nécessaires.
La résolution stipulait:
Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, ils ont le devoir de s’entremettre pour la faire cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. [7]
Le congrès de Bâle de 1912, tenu alors que la guerre approchait, renforça la résolution. Il conserva la même formulation, mais évoqua ensuite la Commune de Paris de 1871 et la Révolution russe de 1905 afin de rendre plus clair le contenu de la résolution.
La réaction de Lénine à la guerre était fondée sur l’analyse développée au cours des années avant la guerre. Il s’agissait d’une guerre impérialiste pour les colonies et le profit. Dès le début, Lénine insista que la trahison de la Deuxième Internationale signait son arrêt de mort. Il fallait rompre avec elle politiquement, idéologiquement et au niveau organisationnel.
Contre toutes les tentatives de dissimuler la signification de ce qui s’était passé, sa faillite « devait être reconnue et ses causes assimilées afin que soit possible la construction d’une unité plus large et plus durable des travailleurs de tous les pays ».
Lénine et le défaitisme révolutionnaire
La ligne stratégique de Lénine pour construire une nouvelle Internationale, une Troisième Internationale, se résumait dans le mot d’ordre « Transformer la guerre impérialiste en guerre civile », énoncé au lendemain de l’éruption de la guerre.
« La transformation de la guerre impérialiste actuelle en guerre civile est le seul mot d’ordre prolétarien juste, enseigné par l’expérience de la Commune, indiqué par la résolution de Bâle (1912) et découlant des conditions de la guerre impérialiste entre pays bourgeois hautement évolués », affirmait une déclaration intitulée La guerre et la social-démocratie russe, publiée en novembre 1914. [8]
Tout le travail de Lénine avant et pendant la Révolution russe, culminant avec la conquête du pouvoir politique en octobre 1917, visait à appliquer cette perspective, non seulement en Russie, faut-il le noter, mais à l’échelle internationale.
Le caractère même de la guerre, une guerre mondiale qui entraînait les travailleurs de tous les pays dans le tourbillon de la mort et de la destruction, signifiait que la stratégie et la tactique du prolétariat ne pouvaient être développées qu’à l’échelle internationale et sur la base d’une perspective commune. Comme Trotsky allait écrire plus tard, août 1914 sonnait le glas de tous les programmes nationaux.
Avant d’examiner les divers et nombreux aspects du travail de Lénine, permettez-moi de corriger quelques conceptions erronées sur le mot d’ordre « transformer la guerre impérialiste en guerre civile ».
Il ne s’agissait pas d’une phrase radicale. Lénine, plus que tous les autres, détestait les déclamations radicales et emphatiques, si typiques de la politique petite-bourgeoise anarchiste, semi-anarchiste et syndicaliste. Il ne s’agissait pas d’aller dans la rue proclamer la nécessité d’une guerre civile. Il ne s’agissait pas non plus de se lancer dans le sabotage ou autres actions du genre, « faire sauter des ponts » comme disait Lénine, pour tenter d’approfondir artificiellement la crise.
Il s’agissait d’élaborer une ligne politique qui expliquerait clairement à la classe ouvrière internationale, par la propagande, l’éducation et l’agitation, la signification historique de la guerre et les tâches révolutionnaires auxquelles elle allait bientôt faire face.
Une résolution écrite par Lénine en mars 1915, dans laquelle il indique les premières étapes à suivre dans ce travail, montre à quel point cette perspective est étrangère au verbiage radical. Les étapes soulignées par Lénine comprennent : (1) refuser de voter pour les crédits de guerre; (2) rompre avec la politique de trêve de classe; (3) former une organisation clandestine dans les pays où les gouvernements ont aboli les libertés constitutionnelles et imposé l’état de siège; (4) soutenir la fraternisation entre les soldats des nations belligérantes; (5) soutenir toute action de masse révolutionnaire menée par la classe ouvrière. [9]
Lénine était conscient qu’une telle activité révolutionnaire affaiblirait le pays en question et pourrait mener à sa défaite. Toutefois, un prolétaire ne pouvait porter des coups à « son » gouvernement, ou tendre la main à un travailleur d’un autre pays en guerre contre le sien sans contribuer à la désintégration et la défaite de « sa » propre grande puissance impérialiste. [10]
La nature de l’impérialisme
L’élaboration de la stratégie du défaitisme révolutionnaire, opposée au « défensisme » et visant à transformer la guerre impérialiste en guerre civile, était fondée sur une analyse scientifique de la nature de l’impérialisme.
La question de l’impérialisme avait été discutée, autant dans les rangs du mouvement marxiste que de manière plus large, durant la période menant à la guerre.
En 1902, au lendemain de la guerre des Boers, le social-libéral anglais John Hobson publia un livre influent intitulé Imperialism: A Study.
Le terme impérialisme n’était pas nouveau. Mais il avait signifié auparavant la consolidation d’un état national fort. Hobson soulignait que le « nouvel impérialisme » différait de l’ancien en ce qu’il impliquait « la théorie et la pratique d’empires rivaux » et la domination du capital financier sur les intérêts commerciaux. Cela entrainait une montée du parasitisme financier, où la richesse était accumulée non tant par l’industrie et le commerce, mais par un important tribut soutiré des colonies et la croissance d’une aristocratie financière utilisant ses vastes richesses pour soudoyer les classes laborieuses afin qu’elles se soumettent à sa domination.
En 1910, le marxiste autrichien Hilferding publiait son ouvrage Le capital financier dans lequel il tentait d’élargir l’analyse de Marx afin de tenir compte de l’immense croissance du capital financier depuis la mort de Marx.
« Aucune compréhension des tendances économiques actuelles, et donc aucune science de l’économie ou de la politique », écrivait Hilferding, « n’est possible sans la connaissance des lois et du fonctionnement du capital financier » [11].
Ces deux ouvrages ont fortement influencé Lénine alors qu’il cherchait. À établir la base théorique de sa perspective. Il a été particulièrement interpellé par l’analyse du parasitisme financier d’Hobson et les conclusions d’Hilferding quant à l’impact du capital financier sur la politique.
Hilferding avait démontré que la domination du capital financier sonnait le glas de la politique libérale du dix-neuvième siècle basée sur la libre compétition et la démocratisation croissante. Le capital financier devait créer une nouvelle idéologie pour répondre à ses besoins. « Cette idéologie … est totalement opposée à celle du libéralisme. Le capital financier ne souhaite pas la liberté, mais la domination. »
Alors que l’ancien libéralisme s’opposait à une politique internationale basée sur l’exercice nu du pouvoir, le capital financier exigeait un État fort « qui puisse intervenir partout pour transformer ce monde en une sphère de placement pour son propre capital financier ». [12]
Cela déterminait les politiques de toutes les grandes puissances, républiques démocratiques et monarchies absolues comprises. La politique du capital financier, c’était, comme disait Lénine, la réaction « sur toute la ligne ».
Dans son œuvre L’impérialisme : Stade suprême du capitalisme, sur lequel il travailla tout au cours de l’année 1915, Lénine rassembla tous les fils de l’analyse qu’il avait développée depuis le début de la guerre. À travers la présentation de statistiques, Lénine décrivit le caractère de la nouvelle époque, et expliqua que la guerre résultait de la poussée agressive du capital financier pour conquérir les marchés, les profits et les colonies.
Comme tout grand ouvrage marxiste, L’impérialisme de Lénine est une polémique. Celle-ci est dirigée contre le leader théorique d’avant-guerre de la social-démocratie allemande, Karl Kautsky, qui joua un rôle central pour fournir une justification théorique au chauvinisme social.
Selon Kautsky, l’impérialisme n’était pas le produit d’un stade ou d’une phase définie du développement capitaliste, mais seulement la politique « privilégiée » de certaines sections de la bourgeoisie, qui incarnaient la volonté des nations industrielles de prendre contrôle de vastes territoires agraires.
Cette définition faisait fi de la caractéristique centrale de l’impérialisme, c’est-à-dire le rôle du capital non pas industriel, mais financier.
De plus, si l’impérialisme n’était qu’une politique « privilégiée » et non basée sur les développements objectifs du capitalisme, alors le mouvement ouvrier pouvait s’orienter vers une alliance avec les sections de la bourgeoisie qui « privilégieraient » une autre politique.
La définition de Kautsky avait un objectif politique central : justifier une opposition à la perspective de la révolution socialiste.
L’analyse de Lénine dans Impérialisme avait trois éléments fondamentaux :
1. Elle montrait comment la guerre avait émergé d’un stade objectif du développement capitaliste, c’est-à-dire le remplacement de la libre concurrence par les monopoles et l’arrivée du capital financier dans une position dominante — ce n’était pas le fruit d’une politique « privilégiée ».
2. La domination du capital financier, la transition vers le capital monopolistique avec d’immenses entreprises, banques et institutions financières opérant à l’échelle mondiale n’avaient pas seulement mené à la guerre. Ces mêmes processus avaient entraîné un vaste changement dans les rapports sociaux de production, une vaste socialisation de la production et du travail.
Ainsi l’impérialisme, basé sur la domination du capital financier parasitaire, n’était pas uniquement un capitalisme moribond. La socialisation de la production entraînée par l’impérialisme signifiait, à l’intérieur de l’économie capitaliste même, le début de la transition vers le socialisme. Cette transition, toutefois, ne pouvait être réalisée que par la défaite de l’opportunisme et la fin de sa domination du mouvement ouvrier.
3. L’opportunisme n’était pas que le produit de la trahison de certains dirigeants corrompus. Il était lié à des processus objectifs nés de l’impérialisme et était organiquement lié aux intérêts des classes dirigeantes capitalistes. L’impérialisme avait permis l’extraction d’énormes profits des colonies par les puissances impérialistes. La bourgeoisie de ces pays avait donc pu créer une couche privilégiée de sections de la petite-bourgeoisie, de journalistes, de bureaucrates syndicaux, d’employés nantis ainsi qu’une section plus privilégiée de la classe ouvrière qui recevait des bénéfices matériels — des miettes venant de la table du banquet impérialiste.
Lénine a tiré de profondes conclusions de cette analyse.
L’impérialisme avait entraîné la transformation des directions officielles de la classe ouvrière en agences ouvertes de la bourgeoisie. C’était le fondement matériel de la nécessité de former une Troisième Internationale.
Comment mener cette lutte était la question de l’heure.
La lutte contre l’opportunisme
Les couches privilégiées, qui formaient la base sociale de la « défense de la patrie », ne constituaient qu’une minorité. Il fallait aller plus loin et plus profondément, dans les « plus basses masses » pour leur expliquer la nécessité de rompre avec l’opportunisme et ainsi les éduquer pour la révolution.
Il s’agissait de porter le coup principal à ceux qui jouaient le rôle le plus dangereux en fournissant aux opportunistes et aux sociaux-chauvins une couverture politique en utilisant des phrases en apparence marxistes. Le leader de cette tendance était Kautsky.
Depuis le début de la guerre, Kautsky, qui avait refusé de s’opposer au soutien du SPD pour les crédits de guerre, tentait de couvrir le chauvinisme social d’un vernis internationaliste.
En octobre 1914, il écrivait: « Tous ont le droit et le devoir de défendre leur patrie; l’internationalisme véritable consiste à reconnaître ce droit aux socialistes de toutes les nations, y compris les nations en guerre avec la mienne. » [13]
Autrement dit, le véritable internationalisme consistait à justifier que les travailleurs allemands tirent sur les travailleurs français, et vice versa, au nom de la « défense de la patrie ».
Une autre tentative de donner à l’opportunisme une couverture « internationaliste » était mise de l’avant par ceux qui invoquaient l’attitude de Marx envers les guerres du dix-neuvième siècle, lesquelles ont mené à la formation des États-nations d’Europe.
Dans toutes ces guerres, Marx avait adopté un point de vue internationaliste, tentant d’évaluer ce qui serait le plus avantageux pour la cause de la démocratie, et donc le plus bénéfique pour la classe ouvrière, si tel ou tel côté l’emporterait. La même méthode, soutenaient certains, devait être adoptée dans la guerre actuelle. Il était nécessaire, sur la base d’une évaluation « internationaliste », de déterminer quel pays devrait l’emporter pour favoriser la classe ouvrière et le socialisme.
Il n’est pas difficile de voir comment une telle position amenait de l’eau au moulin des sociaux-chauvins. Les opportunistes allemands affirmeraient que la défaite du despotisme russe serait plus avantageuse d’un point de vue internationaliste, alors que leurs confrères français affirmaient pareillement que la défaite de l’autocratie prussienne serait plus favorable, aussi d’un point de vue internationaliste.
Cette tentative de donner une couverture internationaliste au social-chauvinisme faisait abstraction des vastes changements survenus depuis que Marx avait écrit sur la question de la guerre.
Au cours des sept premières décennies du dix-neuvième siècle, les guerres nationales étaient liées au renversement de l’absolutisme, alors que les conditions objectives pour l’instauration du socialisme n’étaient pas mûres. Mais depuis cette période, soit près d’un demi-siècle, les classes dirigeantes de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Autriche et de la Russie avaient pillé les colonies et opprimé d’autres nations. C’était cette politique qui était poursuivie dans la guerre actuelle, écrivait Lénine, suivant le dicton de Clausewitz.
De choisir dans la situation actuelle quel pays devrait l’emporter reviendrait à déterminer s’il serait préférable que l’Inde soit pillée par l’Allemagne ou l’Angleterre, que la Chine soit dépecée par les Japon ou les États-Unis, ou que l’Afrique soit étranglée par la France ou l’Allemagne. [14]
Contre les défensistes
En mettant de l’avant la perspective de « transformer la guerre impérialiste en guerre civile », Lénine contrait deux autres arguments importants.
Le slogan pour une fin de la guerre « sans victoire ni défaite » soulevait deux questions décisives.
Premièrement, elle servait de couverture politique aux défensistes. Après tout, les partisans des efforts de guerre pour leur propre gouvernement prétendaient lutter contre la défaite. Comme l’expliquait le dirigeant social-démocrate allemand de droite, Eduard David : « Notre vote du 4 août signifiait que nous n’étions pas pour la guerre, mais contre la défaite. » [15]
Si on est pour la victoire, mais contre la défaite, cela implique qu’on est opposé à une lutte révolutionnaire qui pourrait mener à une défaite militaire de « son » gouvernement. Il fallait donc s’opposer à toute action de la sorte.
Deuxièmement, le slogan « ni victoire ni défaite » soulevait une autre question encore plus importante. Il proposait fondamentalement un retour au statu quo, refusant de reconnaître que la guerre marquait un tournant historique qualitatif.
Toute une époque de développement organique relativement pacifique avait été réduite en cendres par août 14. On ne pouvait plus revenir en arrière.
L’éruption de la guerre résultait du développement économique de l’époque entre 1871 et 1914. Une nouvelle époque avait vu le jour, et si la paix voyait le jour mais les fondations de l’ordre socio-économique demeuraient les mêmes, cette « paix » ne serait que le terreau de nouvelles guerres. Il fallait renverser tout le système par une révolution socialiste internationale.
Le slogan de la « paix » posait la même question, sous une forme légèrement différente, alors que les masses vivaient dans une misère croissante et que la véritable nature de la guerre leur était évidente. À la fin de 1914, des tranchées s’étalaient à travers l’Europe de l’Ouest qui allaient rester en place pour les quatre prochaines années. Les offensives et contre-offensives ne menaient nulle part et n’entraînaient qu’un immense massacre, et aucune fin possible de la guerre ne se dessinait.
Comme l’écrivait la révolutionnaire allemande-polonaise Rosa Luxembourg en 1915, depuis sa cellule à Berlin où elle était détenue en raison de son opposition à la guerre :
La scène a changé fondamentalement. La marche des six semaines sur Paris a pris les proportions d’un drame mondial ; l’immense boucherie est devenue une affaire quotidienne, épuisante et monotone, sans que la solution, dans quelque sens que ce soit, ait progressé d’un pouce. La politique bourgeoise est coincée, prise à son propre piège : on ne peut plus se débarrasser des esprits que l’on a évoqués…Le spectacle est terminé. L’allégresse bruyante des jeunes filles courant le long des convois ne fait plus d’escorte aux trains de réservistes et ces derniers ne saluent plus la foule en se penchant depuis les fenêtres de leur wagon…Dans l’atmosphère dégrisée de ces journées blêmes, c’est un tout autre chœur que l’on entend : le cri rauque des vautours et des hyènes sur le champ de bataille. La chair à canon, embarquée en août et septembre toute gorgée de patriotisme, pourrit maintenant en Belgique, dans les Vosges, en Masurie, dans des cimetières où l’on voit les bénéfices de guerre pousser dru. [16]
Alors que les horreurs de la guerre s’empilaient les unes sur les autres, Lénine soulignait l’importance du désir de paix croissant parmi la population des pays belligérants. Il insistait qu’il était du devoir des socialistes de « prendre ardemment part à toute manifestation inspirée par ce sentiment. »
Mais par-dessus tout, ils devaient expliquer clairement que toute paix sans oppression, annexion et pillage, et sans le danger que de nouvelles éclatent, ne pouvait exister sans un mouvement révolutionnaire.
« Quiconque désire une paix solide et démocratique doit être partisan de la guerre civile contre les gouvernements et la bourgeoisie », écrivait-il. C’est-à-dire qu’ils doivent lutter pour la révolution socialiste. [17]
Kautsky a joué le rôle central pour attaquer cette perspective.
La raison offerte par Kautsky et d’autres pour justifier leur rejet des engagements formulés dans la résolution de Bâle de 1912 était que cette résolution avait envisagé le développement d’une situation révolutionnaire.
Mais lors du déclenchement de la guerre, les masses ont été entraînées par la fièvre de guerre des impérialistes, donc les conditions envisagées par la résolution, selon Kautsky, ne s’appliquaient pas. L’espoir d’une révolution socialiste était donc une illusion, une chimère. Le marxisme, en tant que perspective scientifique, devait se baser non pas sur des illusions mais sur une évaluation objective de la situation.
Il n’y a aucun doute que de larges sections de la population ont succombé aux humeurs bellicistes lorsque la mobilisation a commencé en Europe. Trotsky a expliqué que la raison résidait dans la psychologie de masse et l’isolement apparent de l’avant-garde révolutionnaire lors du déclenchement de la guerre.
En période de paix, l’influence des socialistes touche seulement les sections les plus avancées de la classe ouvrière. De larges couches de la population restent en dehors des luttes politiques immédiates. Mais lorsqu’éclate la guerre et que débute la mobilisation, toutes sont entraînées dans la politique.
La population fait alors face aux questions immédiates de vie et de mort, alors que l’État et l’armée se présentent à elle comme son protecteur et son défenseur. Ces sentiments sont mélangés aux exigences confuses de changement et au désir d’une meilleure situation.
« Les mêmes processus ont lieu au début d’une révolution », écrit Trotsky, « mais avec une différence fondamentale. Une révolution lie ces éléments nouvellement mobilisés à la classe révolutionnaire, mais la guerre les lie au gouvernement et à l’armée! »
Dans un cas, les aspirations confuses et les souffrances se reflètent dans l’enthousiasme révolutionnaire, dans l’autre cas, ces mêmes sentiments « prennent temporairement la forme d’une intoxication patriotique », un état d’esprit qui contamine de larges sections de la classe ouvrière, y compris celles qui ont été influencées par le socialisme. [18]
Dans de telles conditions, Trotsky poursuit, le parti ne peut lancer immédiatement une lutte révolutionnaire. Il peut, cependant, exprimer son opposition à la guerre, n’offrir aucune confiance au gouvernement, refuser de voter pour les crédits de guerre et, ainsi, se préparer aux changements que la guerre entraînera inévitablement dans la conscience des masses.
Le fait que cela ne se soit pas produit, que la mobilisation ait aussi donné le signal pour le naufrage de l’Internationale, que les partis sociaux-démocrates et travaillistes aient « soutenu leurs gouvernements sans aucune critique » signifiait qu’il y avait des causes plus profondes.
Lénine, plus que tout autre, a étudié ces causes à fond et, ainsi, a développé la stratégie et la tactique politiques qui allaient mener à la prise du pouvoir par la classe ouvrière.
Ceux qui cherchaient à défendre les opportunistes ont commencé à présenter une image erronée de la situation lors du déclenchement de la guerre. Kautsky écrivait en octobre 1914 que « jamais un gouvernement n’est aussi fort et jamais les partis ne sont aussi faibles qu’au début d’une guerre. »
En fait, Lénine répondit que « jamais le gouvernement n’a autant besoin de l’entente entre tous les partis des classes dominantes et de la soumission “pacifique” des classes opprimées à cette domination que pendant la guerre » [19].
De plus, continuait-il, les gouvernements peuvent sembler tout puissants, mais « l’apparence » ne concorde pas avec la réalité, et personne n’a associé l’attente d’une situation révolutionnaire au seul « début » d’une guerre. Il ne s’agissait que du début d’un processus, et déjà en 1915, Lénine écrivait que les symptômes d’une situation révolutionnaire se développaient dans tous les pays alors que montait le mécontentement des masses et que les gouvernements exigeaient toujours plus de sacrifices à la population.
Cette situation se maintiendra-t-elle encore longtemps et à quel point s’aggravera-t-elle ? Aboutira-t-elle à la révolution ? Nous l’ignorons, et nul ne peut le savoir. Seule l’expérience du progrès de l’état d’esprit révolutionnaire et du passage de la classe avancée, du prolétariat, à l’action révolutionnaire le prouvera. [20]
De plus, l’absence de luttes révolutionnaires au début de la guerre était le résultat de la situation à laquelle était confrontée la classe ouvrière. Dans tous les pays, elle faisait face à la censure et à l’état de siège, ainsi qu’à la trahison de sa direction, qui serrait les rangs avec les gouvernements impérialistes qui imposaient ces mesures.
Philosophie matérialiste et pratique révolutionnaire
Au-delà de la situation immédiate, les questions soulevées par Lénine sont d’une importance méthodologique majeure. Cela nous ramène au point 7 de la conférence de David North dans laquelle il souligne la « relation essentielle entre la philosophie matérialiste scientifique et la pratique révolutionnaire ».
Lénine soulignait l’élément suivant : la situation était objectivement révolutionnaire en ce que les classes dirigeantes ne pouvaient plus diriger comme avant, tout comme les masses ne pouvaient plus vivre comme avant. Mais il est impossible de déterminer par la seule contemplation si cette situation objectivement révolutionnaire produirait en fait une révolution. Il s’agissait de développer une pratique révolutionnaire.
Le contenu réel de la situation — la question de savoir si son potentiel pouvait se concrétiser — ne pouvait être dévoilé que par l’intervention du facteur subjectif conscient, le parti révolutionnaire cherchant à développer le mouvement de la classe ouvrière, lui révélant la situation objective à laquelle elle faisait face et armant ses luttes d’un programme clair, élaboré en profondeur, ayant pour cible la conquête du pouvoir politique.
L’importance que portait Lénine à la nécessité de saisir la situation réelle, plutôt que sa simple « apparence », soulignait le point clé fait par Marx dans ses thèses sur Feuerbach, dans lesquelles il avait élaboré son développement décisif de la philosophie matérialiste.
Kautsky et d’autres prétendaient s’inscrire dans les traditions du matérialisme contre les illusions de Lénine et sa perspective de guerre civile et de révolution pour renverser la bourgeoisie.
Mais ces derniers ne se basaient pas sur le matérialisme de Marx, mais plutôt sur la perspective qu’il avait supplantée en intégrant au matérialisme antérieur les acquis de la philosophie idéaliste allemande — celle d’Hegel principalement — laquelle mettait de l’avant l’importance du côté actif, c’est-à-dire de l’activité humaine, dans le processus historique.
Dans la première de ses thèses sur Feuerbach, Marx écrivait : « Le principal défaut, jusqu’ici, du matérialisme de tous les philosophes — y compris celui de Feuerbach est que l’objet, la réalité, le monde sensible n’y sont saisis que sous la forme d’objet ou d’intuition, mais non en tant qu’activité humaine concrète, en tant que pratique, de façon non subjective ». L’ancienne philosophie matérialiste n’avait donc pas saisi « l’importance de l’activité “révolutionnaire”, de l’activité “pratique-critique” ». [21]
Par opposition à Kautsky, Lénine expliquait qu’aucun socialiste n’avait jamais garanti que la guerre actuelle, plutôt que la prochaine, produirait une révolution. Le point était qu’il était du devoir des socialistes d’éveiller la conscience révolutionnaire de la classe ouvrière en révélant l’existence d’une situation révolutionnaire.
Le marxisme contre le social-chauvinisme
La question déterminante était celle-ci : comment est-ce possible que les plus éminents représentants du socialisme international aient trahi la classe ouvrière? La réponse se trouvait dans l’analyse matérialiste des origines de la tendance social-chauvine.
Pendant la période d’avant-guerre, une décennie et demie plus tôt, le mouvement socialiste avait été déchiré par une division fondamentale sur sa perspective.
Le socialisme se réaliserait-il par un développement calme et graduel, par l’accumulation de réformes via l’activité parlementaire et syndicale, ou par l’effondrement du système capitaliste et l’éruption de luttes révolutionnaires?
En 1898, le dirigeant social-démocrate allemand Eduard Bernstein avait proposé une révision majeure de la perspective fondamentale du parti. Résumant la conception de la tendance gradualiste, il avait affirmé que le mouvement était tout et que le but final n’était rien. Dans sa position formelle, le SPD avait repoussé la tendance révisionniste. Mais la pratique sur laquelle se basait le révisionnisme, la collaboration de classe et l’intégration à la structure même de la domination bourgeoise, continuait de gagner du terrain.
La question a refait surface au lendemain de la révolution de 1905 en Russie. La révolution, avec ses grèves générales de masse et la formation de soviets ou de conseils ouvriers, que Fred Williams a brillamment décrit il y a deux semaines, allait-elle être le fer-de-lance de la révolution européenne, montrant la forme qu’elle allait prendre comme insistait Rosa Luxembourg? Ou était-elle, comme l’affirmaient ses opposants, principalement dans les syndicats, une expression de l’état arriéré de la Russie, sans aucun lien avec l’Europe de l’Ouest avancée?
La trahison de la Deuxième Internationale a mis les choses au point. La source de cette trahison était la croissance de la tendance opportuniste, qui avait atteint sa pleine maturité et était passée directement dans le camp de la bourgeoisie pendant la guerre.
L’analyse par Lénine des bases matérielles de cette tendance avait de profondes conséquences politiques : la nouvelle Internationale, la Troisième, ne pouvait être reconstituée avec ce qui restait de la Deuxième, ni être établie sur la base de sa théorie et de sa pratique.
La Deuxième Internationale, expliquait Lénine, avait mené un travail préparatoire important dans la période du développement « graduel ». Mais la Troisième Internationale faisait face à de nouvelles tâches : la lutte révolutionnaire immédiate contre les gouvernements capitalistes, la guerre civile contre la bourgeoisie, la prise du pouvoir politique et le triomphe du socialisme.
Cela nécessitait une rupture politique, idéologique et organisationnelle totale avec l’opportunisme qui, durant la période de la Deuxième Internationale, était considérée comme une tendance « légitime » à l’intérieur du mouvement socialiste.
En Russie, cette séparation politique et organisationnelle avait été menée lors de la scission avec les menchéviks. Pour Lénine, sa signification internationale devenait maintenant claire.
La division entre les bolchéviks et les menchéviks avait débuté lors du congrès de 1903 du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. À ce moment, c’était quelque peu flou, car la division s’était développée par rapport à une phrase expliquant ce en quoi devait consister l’adhésion au parti.
Avec l’éruption de la révolution de 1905, la base de classe de la divergence a commencé à faire surface. La politique des bolchéviks était basée sur l’hostilité à la bourgeoisie libérale. Celle des menchéviks consistait en une conciliation avec la bourgeoisie libérale, exprimée par Plekhanov lorsqu’il déclara que les ouvriers de Moscou n’auraient pas dû prendre les armes lors du soulèvement de décembre.
Selon eux, la tâche en Russie était de mener une révolution démocratique bourgeoise, mettre fin à l’absolutisme féodal et porter au pouvoir un régime bourgeois. Les actions à Moscou allaient seulement repousser la bourgeoisie libérale et l’empêcher de jouer son rôle historique. Il était donc nécessaire, selon Plekhanov, d’agir avec « tact » avec le parti bourgeois des Cadets.
Les conflits continuèrent après 1905 et étaient perçus à l’intérieur de l’Internationale comme une particularité russe. « Ils reviennent encore avec cela » était une réaction habituelle.
La trahison de la Deuxième Internationale soulevait la nécessité d’une rupture organisationnelle totale avec l’opportunisme et ses défenseurs. La signification internationale de la scission avec les menchéviks était devenue évidente pour Lénine.
En Russie, la séparation complète du mouvement prolétarien d’avec les éléments opportunistes petits-bourgeois avait été préparée par toute l’histoire du mouvement ouvrier, écrivit Lénine.
C’est rendre à celui-ci le pire des services que de faire abstraction de cette histoire et de déclamer contre le “fractionnisme”, en se privant de la possibilité de comprendre comment le parti prolétarien en Russie s’est formé au cours d’une longue lutte contre les diverses variétés d’opportunisme…
La lutte en Russie avait une signification internationale, car elle était basée, en dernière analyse, dans les mêmes processus qui avaient produit l’opportunisme au sein de la Deuxième Internationale et abouti à sa trahison en 1914. Le même développement « européen », où une couche privilégiée de la petite-bourgeoisie acquiert certains privilèges liés au statut de « grande puissance » de « sa » nation, avait son pendant en Russie sous la forme du menchévisme, écrivit Lénine.
Mais en Russie, il y avait eu une rupture, tant politique qu’organisationnelle, avec ces forces. Voilà la tactique « internationaliste », systématiquement révolutionnaire, qu’il s’agissait maintenant d’élargir. [22]
La conférence de Zimmerwald
Cette lutte avait débuté lors de la conférence socialiste contre la guerre tenue, en secret, dans le petit village suisse de Zimmerwald du 5 au 8 septembre 1915. La réservation d’hôtel avait été faite au nom d’une société d’ornithologie. Il n’y a pas eu d’observation d’oiseaux, même si de véritables aigles de la pensée humaine étaient présents, avant tout Lénine et Trotsky.
La conférence de Zimmerwald a été organisée par le socialiste suisse Robert Grimm. Sa perspective, et celle de ses partisans, qui représentaient la majorité des 43 délégués, était très loin de celle de Lénine.
L’objectif de Grimm n’était pas de lancer un mouvement contre la guerre, mais d’ôter à la Deuxième Internationale les taches de la trahison du 4 août, et de rétablir ses fondements d’avant-guerre en avançant le slogan général pour la paix.
Il y avait une large fraction de gauche, minoritaire, et à l’intérieur de cette fraction il y en avait une encore plus petite encore, constituée d’environ cinq individus regroupés autour de Lénine.
Lénine ne se faisait pas d’illusions sur le résultat de la conférence. Il voyait celle-ci comme un pas de l’avant dans l’unification internationale de véritables forces marxistes, aussi petites soient-elles.
Le socialiste de gauche suisse Fritz Platten rappela qu’au cours de la conférence, Lénine était le participant le plus attentif, parlant rarement et jamais très longtemps. Mais lorsqu’il parlait, ses mots avaient « l’effet d’une douche caustique ». C’était la perspective de Lénine — il était le seul à avoir présenté une proposition de résolution pour la conférence — qui avait donné le ton à la plupart des discussions.
Selon Platten, « La force de Lénine consistait en ce qu’il percevait les lois du développement historique avec une clarté phénoménale » [23].
C’était l’accent que Lénine avait mis sur ces lois qui déterminait son attitude face aux tentatives de ranimer la Deuxième Internationale en nettoyant les taches du 4 août.
La faillite de la Deuxième Internationale n’était pas simplement le résultat de la trahison de sa direction. Elle marquait la fin de toute une ère historique de développement relativement pacifique. Une nouvelle ère de guerres et de révolution voyait le jour. Une nouvelle Internationale devait être construite, sur de nouveaux fondements, afin de faire face à de nouvelles tâches.
Le slogan proposé était en faveur de la paix. Mais il réunissait toutes les grandes questions : comment pourrait-il y avoir la paix sans le renversement du système capitaliste, dont le développement historique vers l’impérialisme avait mené à la guerre? Et cette tâche ne pouvait être accomplie sans une rupture totale et une lutte intransigeante contre tous ceux qui en étaient venus à représenter les intérêts de l’impérialisme à l’intérieur du mouvement ouvrier.
Au soir du 7 septembre, le délégué français, Alphonse Merrheim, résuma les divergences. La majorité souhaitait des actions prolétariennes de paix, non des formules étroites, dit-il. Merrheim n’était pas contre la révolution, mais insistait qu’un « mouvement révolutionnaire ne peut croître que par une lutte pour la paix. Vous, camarade Lénine, n’êtes pas motivé par une lutte pour la paix, mais par le désir de fonder une nouvelle Internationale. Voilà ce qui nous divise. » [24]
La conférence de Zimmerwald s’est conclue par l’adoption d’un manifeste, rédigé par Trotsky et signé par tous les délégués, contre la guerre impérialiste. Il ne représentait en rien ce que Lénine, ou même Trotsky, avait souhaité. Mais c’était une avancée, un pas en avant, comme disait Lénine, « vers la rupture idéologique et pratique avec l’opportunisme et le social-chauvinisme. » [25]
Dans les mois suivants, Zimmerwald allait être associé à l’opposition grandissante à la guerre alors que le contenu du manifeste, qui dénonçait l’impérialisme, faisait son chemin dans la conscience de larges sections de la classe ouvrière, accablées par les privations et la boucherie de la guerre.
Les fondements d’une nouvelle Internationale
Mais les problèmes que la conférence n’avait pu résoudre étaient toujours présents.
Ceux-ci étaient articulés dans une résolution présentée par Rosa Luxembourg en mars 1916 qui portait sur les fondements d’une nouvelle Internationale. Elle ne pouvait voir le jour, écrivit-elle, que comme résultat de luttes révolutionnaires de masse, dont la première étape devait être l’action de masse pour forcer le retour de la paix.
L’existence et la viabilité de l’Internationale n’est pas une question organisationnelle. Il ne s’agit pas de parvenir à des accords à l’intérieur d’un cercle restreint d’individus qui se présentent comme les représentants des couches de la population enclines à l’opposition. Il s’agit plutôt de la question du mouvement de masse du prolétariat de tous les pays. [26]
Il y avait là une différence fondamentale avec les conceptions de Lénine. Il ne faisait aucun doute que la guerre provoquerait des luttes de masse révolutionnaires. Mais la question cruciale était de savoir si, avant l’éclatement de ces luttes, il existait une direction révolutionnaire qui avait assimilé et élaboré les éléments clés du programme nécessaire et qui, surtout, avait affirmé clairement son hostilité à toutes ces tendances politiques, surtout celles ayant émergé du mouvement ouvrier même qui, ayant appuyé l’effort de guerre, tenteraient de faire dérailler la révolution.
Ce n’est que sur la base d’une telle préparation que l’éruption d’une révolution — un produit des mêmes conditions ayant mené à la guerre — pouvait mener à la prise du pouvoir par la classe ouvrière.
L’année 1917 allait démontrer la justesse de cette perspective. Un an et demi seulement après la conférence de Zimmerwald, la Révolution de février éclatait, suivie huit mois plus tard par la Révolution d’octobre.
Dans sa Lettre d’adieu aux ouvriers suisses, alors qu’il entamait son voyage de retour vers la Russie, Lénine écrivait :
Lorsque notre parti lança en novembre 1914 le mot d’ordre : « transformation de la guerre impérialiste en guerre civile » des opprimés contre les oppresseurs, pour le socialisme, ce mot d’ordre fut accueilli par l’hostilité et les sarcasmes des social-patriotes, par le silence méfiant et sceptique, veule et attentiste, des sociaux-démocrates du « centre » … Depuis mars 1917, il n’est plus que des aveugles pour ne pas voir que ce mot d’ordre est juste. La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile devient un fait. Vive la révolution prolétarienne qui commence en Europe! [27]
Notes
[1] Cité (et traduit de l’anglais) dans Hamilton and Herwig, Decisions for War, 1914–17 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 19
[2] Traduit de l’anglais, Niall Ferguson, The Pity of War (London: Allen Lane, 1998), p. 31
[3] Cité (et traduit de l’anglais) dans Fritz Fischer, War of Illusions: German Policies from 1911 to 1914 (London: Chatto & Windus, 1975), p. 449
[4] Cité (et traduit de l’anglais) dans David Stevenson, Armaments and the Coming of War (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 391
[5] Cité (et traduit de l’anglais) dans Paul Kennedy, The Rise of Anglo-German Antagonism (London: The Ashfield Press, 1987), p. 467
[6] Traduit de l’anglais, Frederick Engels, “Introduction” to Sigismund Borkheim’s pamphlet, In Memory of the German Blood-and-Thunder Patriots 1806–1807, in Marx-Engels Collected Works, Vol. 26 (London: Lawrence & Wishart, 1990), p. 451.
[7] Résolution du Congrès de Stuttgart de la Deuxième Internationale, (https://wikirouge.net/Internationale_Ouvrière#Congr.C3.A8s_de_Stuttgart_.281907.29)
[8] Lénine, Œuvres, Tome 21, (Paris : Éditions sociales, 1976), p. 28
[9] Ibid., p. 160
[10] Ibid., p. 287
[11] Traduit de l’anglais, Rudolf Hilferding, Finance Capital (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), p. 21.
[12] Ibid., p. 334.
[13] Cité dans Lénine, Œuvres, Tome 21, p.223
[14] Lénine, Œuvres, Tome 21, p. 187
[15] Cité dans Lénine, Œuvres, Tome 21, p. 287
[16] Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, socialisme ou barbarie ( https://www.marxists.org/francais/luxembur/junius/rljaf.html)
[17] Lénine Œuvres, Tome 21, p. 327
[18] Traduit de l’anglais, Leon Trotsky, The War and the International, (OakPark, MI: Mehring Books, 2017), p. 60.
[19] Lénine, Œuvres, Tome 21, p. 218
[20] Ibid., p. 219
[21] Karl Marx, Thèses sur Feuerbach ( https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450001.htm)
[22] Lénine, Œuvres, Tome 21, p. 265
[23] Traduit de l’anglais, Catherine Merridale, Lenin on the Train (London: Allen Lane, 2016), p. 86.
[24] Cité (et traduit de l’anglais) dans R. Craig Nation, War on War (Chicago: Haymarket Books, 2009), p. 89
[25] Lénine, Œuvres, Tome 21, p. 398
[26] Cité (et traduit de l’anglais) dans R. Craig Nation, War on War, p.95
[27] Lénine, Œuvres, Tome 23, p. 402-403