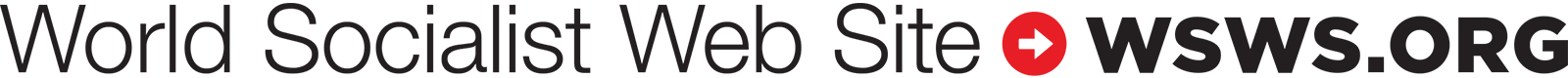Un roman sur la vie des travailleurs est l’exception à la règle dans l’édition américaine contemporaine, qui a eu tendance au XXIe siècle à trouver son centre de gravité thématique dans les questions de confusion, de politique identitaire et de pessimisme de la classe moyenne, à mesure que les crises du capitalisme s’intensifient. Il n’est pas nécessairement vrai qu’aucun livre sur la vie des travailleurs n’est écrit, mais l’industrie de l’édition n’est certainement pas avide de livres sur ce sujet.
Il y a des exceptions. La mort du romancier Russell Banks au début de l’année a été une véritable perte. Nous avons récemment écrit sur le roman de John M. Hamilton, A Hell Called Ohio, paru en 2013. Et le roman de Tess Gunty, The Rabbit Hutch, lauréat du National Book Award en 2022, suit la vie d’une jeune caissière dans une ville moribonde de la Rust Belt.
Les sources varient considérablement quant au nombre de nouveaux livres, de fiction et de non-fiction, publiés chaque année aux États-Unis, mais on s’accorde à dire que ce nombre se situe entre 500.000 et 1 million, auxquels s’ajoutent 1,5 million de titres autoédités. Malgré ces chiffres qui peuvent sembler impressionnants, seuls 1 à 2% des romans complétés dans une année sont acceptés par les éditeurs traditionnels.
La popularité relative des différents genres littéraires peut être calculée sur la base des chiffres de vente. Les éternels vainqueurs sont les romans d’amour, les romans policiers et les romans de science-fiction/fantastique. La littérature pour jeunes adultes (Y/A) et les bandes dessinées sont également très populaires. Selon un sondage de Goodreads.com, le genre le moins populaire est la fiction littéraire, catégorie qui comprend les romans socialement réalistes.
Compte tenu de la réalité de la popularité des genres, de la nature hautement sélective de l’édition et des pressions exercées sur l’édition par les préoccupations de la classe moyenne, relativement peu d’œuvres de fiction sérieuses sont publiées. Ce qui est publié traite principalement des crises et des intérêts des professionnels.
Dans l’ensemble, les romans qui s’attachent à dépeindre honnêtement les luttes quotidiennes des travailleurs, à supposer que de tels romans soient écrits, se heurtent à des obstacles considérables dans leur quête de publication. Le premier de ces obstacles est la recherche d’un agent littéraire.
Les gardiens de la littérature
Les agents sont les gardiens du secteur de l’édition. Les écrivains doivent trouver un agent pour représenter leur roman auprès des éditeurs. Presque aucun roman n’est transmis à un éditeur s’il ne correspond pas aux goûts personnels de l’agent. Qui sont donc ces agents littéraires?
Une étude rapide des sites web des agences littéraires les plus importantes et les plus prestigieuses en dit long sur leurs agents et sur les livres qu’ils choisissent de représenter. La moitié de ces arbitres du goût du public sont des jeunes d’une vingtaine d’années, fraîchement diplômés d’une école d’anglais ou de littérature comparée. Comme tous les jeunes d’une vingtaine d’années, ils font les basses besognes de l’industrie et sont inondés de demandes (propositions) d’auteurs. Les demandes qui ont le plus de chances d’être sélectionnées sont naturellement celles qui répondent aux préférences des agents. Et quelles sont ces préférences?
Lorsque l’on consulte les notices biographiques de ces jeunes agents – et des moins jeunes –, on tombe sans cesse sur des phrases telles que «Je suis attiré par la bonne fantaisie», «Je cherche du Y/A», «Je suis particulièrement intéressé par des histoires avec un protagoniste féminin fort» et «Je suis intéressé par ceux qui repensent la mythologie et les contes de fées pour des lecteurs adultes». Ces préférences dominent même parmi les agents qui sollicitent également des romans «littéraires/de club de lecture», c’est-à-dire des ouvrages censés être sérieux.
Bien entendu, nombre de ces agents sont sensibles à la qualité de l’écriture et aux thèmes adultes, et il est certain que de bons ouvrages sont publiés. On ne peut pas non plus leur reprocher d’essayer de gagner leur vie – après tout, le fantastique se vend. Mais au-delà des agents en tant qu’individus, leurs goûts sont représentatifs d’une approche littéraire de la classe moyenne supérieure – parmi les lecteurs et les écrivains – qui, à ce moment crucial de l’histoire, tend à rechercher des personnages modèles («forts») et à s’évader dans l’enfance, la magie et un passé historique romanesque.
Lorsque des thèmes adultes et des contextes réalistes sont abordés dans la fiction contemporaine, la tendance prédominante est de présenter des problèmes – violence conjugale, alcoolisme, sexisme, pour n’en citer que quelques-uns parmi les best-sellers actuels – afin de les «surmonter» grâce à un protagoniste «fort». La résilience individuelle, le «courage» (le terme de l’heure) et les choix personnels deviennent le point de mire.
Cette approche de l’expérience humaine contraste avec un roman comme Germinal (1885) d’Émile Zola. La description que fait Zola d’une communauté de mineurs de charbon dans le nord de la France est austère, parfois brutale, et ses personnages ne sont ni plus forts ni plus faibles que ceux qui ont le droit de l’être dans de telles circonstances. De nombreux personnages de Zola font preuve de détermination individuelle, mais la force du roman, et la réalité de l’existence sous le capitalisme, résident dans le fait que la détermination de l’individu ne peut rien contre l’oppression de classe, le travail épuisant et la pauvreté déshumanisante.
En 2023, les États-Unis ne manquent pas d’oppression, d’exploitation et de pauvreté. Aujourd’hui, de nombreux travailleurs endurent des journées de travail de 12 heures dans des usines dangereuses et dégradantes, avec des salaires qui ne suivent pas l’inflation. D’autres armées de travailleurs sont obligées de dépendre des revenus dérisoires des emplois dans le commerce de détail et des «petits boulots» irréguliers comme Uber et DoorDash. Comme l’a rapporté le WSWS, même le travail des enfants revient de manière significative dans le capitalisme contemporain.
Où est donc notre Zola? Notre Dickens, notre Tolstoï, ou nos contemporains Dreiser, Hemingway, Dos Passos ou Steinbeck? En d’autres termes, où sont les auteurs qui, sans être nécessairement socialistes, reconnaissent que la société elle-même est malade et mérite une critique sans complaisance et que la vie des opprimés est précieuse et mérite d’être examinée?
Sans parler des auteurs qui reconnaissent, comme Zola l’a fait dans une certaine mesure, que la classe ouvrière est potentiellement immensément puissante. Pendant quelques chapitres émouvants de Germinal, la classe ouvrière organisée est le plus fort des protagonistes.
L’émergence d’un Zola, ou d’un Dreiser, n’était pas simplement une question de volonté ou de sincérité personnelle. Les événements historiques et les processus politiques, y compris l’émergence d’un mouvement ouvrier socialiste de masse, ont joué un rôle essentiel. Le WSWS a souvent écrit sur l’immense culture socialiste qui a émergé dans le dernier tiers du 19e siècle. L’interaction complexe mais productive entre l’art et le socialisme a été l’une des caractéristiques dominantes de la vie culturelle dans les décennies qui ont précédé la révolution russe de 1917.
Zola et d’autres ont bénéficié d’une période historique marquée par une conscience de classe accrue chez les travailleurs, une agitation de masse alternant avec une répression féroce (la Commune de Paris de 1871 n’a précédé Germinal que de 14 ans) et la prolifération d’idées socialistes parmi les travailleurs et l’intelligentsia d’Europe.
Les difficultés sont nombreuses dans la situation actuelle, y compris les résidus idéologiques des crimes du stalinisme, mais un vaste mouvement de la classe ouvrière se construit, en réponse aux attaques incessantes de l’élite dirigeante, à l’horrible pandémie et au danger de la guerre et de la dictature. Ce mouvement contribuera inévitablement à dissiper les nuages de scepticisme et de pessimisme et à faire progresser les connaissances sociales et la pensée des artistes socialistes. Nous finirons par avoir notre Zola.
Art et identité
La nouvelle règle officieuse selon laquelle un artiste ne peut pas choisir un sujet, dépeindre un monde ou créer un protagoniste dont la couleur de peau ou le sexe diffère du sien est particulièrement préjudiciable à la culture artistique et littéraire de notre société.
Cette position, adoptée par des éléments égoïstes de la classe moyenne supérieure, se résume en fin de compte à une lutte pour le nombre limité de dollars consacrés à l’art, à la littérature et à la musique. «Rester dans sa voie» est le refrain popularisé de cette proscription égoïste, et il est respecté par une proportion inquiétante d’artistes par ailleurs réputés.
Un écrivain avec lequel ce journaliste s’est récemment entretenu s’est humblement vanté de ne jamais écrire sur un groupe dont il a bénéficié de l’oppression. Et il n’était pas PDG d’une grande entreprise! Même s’il a bénéficié de l’oppression de quelqu’un d’autre, à l’exception de l’oppression de classe, ce qui est peu probable en 2023, la relation logique avec le fait qu’il n’écrive pas sur ce groupe opprimé est difficile à discerner.
L’art est toujours une approximation, jamais totalement réussie, mais lorsqu’elle est bien faite, elle saisit l’altérité et la similitude de l’auteur, du lecteur et du sujet dans un acte de recherche et de compassion. Séparer les sujets des artistes revient à nier la nature même de l’art et à nier l’activité fondamentale de l’être humain.
Émile Zola n’était pas mineur de charbon. Il a certainement bénéficié du travail dans les mines de charbon. Mais personne, avant ou après lui, n’a écrit de manière aussi efficace et touchante sur les mineurs et l’exploitation minière. Il convient de noter que le cortège funèbre de Zola avait été rejoint par des mineurs de charbon du nord de la France.
Les lecteurs sensibles
Une nouvelle forme de censure dans l’édition accompagne la montée des politiques identitaires. Les nouveaux censeurs sont appelés «lecteurs de sensibilité».
En bref, les lecteurs de sensibilité fonctionnent comme les inquisiteurs de «la diversité, l’équité et l’inclusion» de l’industrie de l’édition, lisant les manuscrits et recherchant du matériel potentiellement «offensant» ou «inexact».
Les lecteurs de sensibilité sont généralement des indépendants qui se présentent comme ayant un produit vendable – leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou tout autre attribut physique ou culturel – qui peut être utile aux éditeurs. Ces personnes sont généralement appelées par les éditeurs pour vérifier un manuscrit dont l’auteur s’est écarté de sa «voie» ou risque d’une manière ou d’une autre d’être considéré comme «problématique».
«Je n’édite jamais directement un texte», a récemment déclaré au Guardian (Royaume-Uni) la lectrice de sensibilité Helen Gould (dont les spécialités sont l’identité raciale et la santé mentale). Lucy Knight, rédactrice au Guardian, explique que «lorsqu’on lui demande d’effectuer une lecture de sensibilité, [Gould] lit le texte, annote les sections où elle pense que des changements spécifiques pourraient être apportés [...] et fournit des commentaires généraux». Knight rassure le lecteur: «Les auteurs et les éditeurs peuvent alors choisir d’accepter ses suggestions et d’apporter les changements, de les ignorer ou de demander à en discuter davantage.»
La vérité est qu’aujourd’hui, aucun éditeur ne prendra le risque d’exposer sa maison d’édition, son employeur, à des accusations d’«insensibilité», et l’auteur – toujours le dernier échelon de cette échelle – sera obligé d’accepter les changements ou de sacrifier la rémunération d’un travail d’un an ou plus. Telle est la mécanique de l’art sous le capitalisme.
Le Guardian, porte-parole libéral de l’impérialisme britannique et américain en matière de «droits de l’homme», insiste sur le fait qu’il n’y a rien à voir ici, que les lecteurs sensibles ne font rien de nouveau «étant donné qu’un aspect du travail des éditeurs de livres a toujours été de réfléchir à la façon dont le texte sera perçu». Il s’agit là d’un argument superficiel et fallacieux.
Les éditeurs de livres sont, dans l’idéal, des personnes très instruites dont les premières préoccupations devraient être la qualité artistique et la véracité sociale d’une œuvre. Les éditeurs savent que les narrateurs sont parfois peu fiables, parfois imparfaits, parfois carrément méprisables. Ils savent que certains personnages, comme tous les humains, ont des pensées qui, pour reprendre les termes de Mark Twain, «feraient honte au diable». Les bons éditeurs de livres savent qu’il y a beaucoup de choses offensantes dans la réalité, tant dans l’esprit qu’à l’extérieur. Pourtant, le travail du lecteur sensible est d’extirper ces éléments au nom des lecteurs les moins compétents, ceux qui sont offensés par la réalité objective et ne souhaitent pas la voir.
L’imposition de la politique identitaire de la classe moyenne supérieure à la culture est de la censure et du philistinisme. Mais elle est aussi réactionnaire. Les cibles ultimes de la politique identitaire et du langage de l’«offense» et de la «sensibilité» sont la classe ouvrière et ses droits démocratiques. Des concepts tels qu’«offense» et «sensibilité» sont des abstractions nébuleuses et sujettes à une interprétation large, pour ne pas dire néfaste. Alors qu’aujourd’hui, il peut être considéré comme offensant de traiter quelqu’un de «gros», à l’avenir, on pourra nous dire que les questions de classe, de lutte des classes et de socialisme sont dérangeantes et offensantes. En effet, aux États-Unis et dans le monde, les déclarations et les réunions anti-guerre sont qualifiées d’«insensibles» par les nationalistes ukrainiens.
En d’autres termes, la politique de l’identité, en plus de fournir une prime de carrière à des éléments de la petite-bourgeoisie, sert d’outil pour défendre l’oppression de la classe ouvrière.
Les représentations «blackout»de pièces de théâtre où ceux qui ne sont pas noirs ne sont pas les bienvenus, comme la production en 2021 d’un Macbeth réimaginé à Harvard, l’orgie actuelle d’interdiction de livres par la droite et l’annulation anti-Russie de la représentation prévue par l’orchestre philharmonique de New York de la symphonie «Leningrad» du compositeur soviétique Dimitri Chostakovitch témoignent d’un virulent mouvement anti-intellectuel et anti-art visant à nier la culture et à diviser les travailleurs selon des critères de race, de nationalité et de religion.
Mais les travailleurs – tous les travailleurs – sont poussés par le capitalisme au-delà de ce qu’ils peuvent supporter et s’engagent de plus en plus dans des grèves et des protestations qui ignorent et effacent ces lignes de division artificielles. Dans un environnement instable de réaction intense et de militantisme croissant, l’art qui tente de représenter les réalités de la vie de la classe ouvrière – de tous les travailleurs – ne sera plus étouffé très longtemps.
(Article paru en anglais le 31 mai 2023)