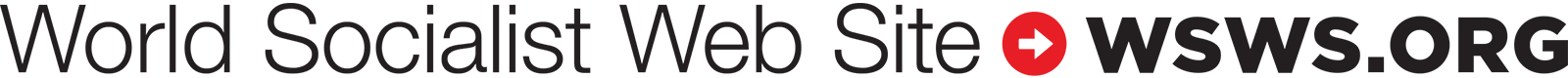Le soir de la Saint-Sylvestre, la famille de John Pilger a annoncé que le célèbre journaliste était décédé la veille à Londres, à l’âge de 84 ans. Né en Australie, Pilger avait travaillé de nombreuses années en Grande-Bretagne, partageant son temps entre les deux pays.
La carrière de Pilger dans les médias s’est étalée sur des décennies, commençant à la fin des années 1950 et sans interruption jusqu’à ces dernières années. Il représentait une couche de journalistes radicalisés par la criminalité de la guerre du Vietnam et attachés aux préceptes fondamentaux du journalisme d’investigation, notamment la dénonciation des guerres, des mensonges de gouvernements et des attaques contre les droits démocratiques.
La trajectoire de la carrière de Pilger a mis en évidence le rejet de plus en plus ouvert de ces principes par les médias officiels et les journalistes. Alors que pendant de nombreuses décennies, les révélations de Pilger ont été publiées par les principaux médias et ses films largement distribués, dans la dernière période de sa carrière, Pilger a été largement ostracisé par les médias grand public. Malgré son long palmarès, la nouvelle de la mort de Pilger a été rapportée de manière sommaire, y compris par les médias pour lesquels il avait écrit autrefois.
La raison n’est pas difficile à deviner. Ces publications et leurs journalistes chevronnés fonctionnent désormais comme des propagandistes de guerre sans fard. La mort de Pilger a coïncidé avec leur promotion du génocide israélien des Palestiniens à Gaza, l’un des pires crimes de guerre des 80 dernières années, ainsi qu’avec leur soutien aux affrontements menés par les États-Unis contre la Russie et la Chine, qui brandissent la menace d’une guerre mondiale catastrophique.
Dans ces conditions, un reportage vaguement critique, et encore plus un journalisme anti-guerre, est inacceptable pour les médias de l’establishment. Dans la dernière période de sa vie, Pilger a condamné l’attaque contre Gaza et a mis en garde contre le danger d’un conflit plus large.
Au cours de sa longue carrière, Pilger a écrit ou édité de nombreuses œuvres et réalisé des dizaines de documentaires.
Suite à son embauche dans les médias en tant que lecteur d’épreuves à Sydney en 1958, Pilger se rendit en Europe peu de temps après et s’installa à Londres. C’est une voie suivie par nombre de ses contemporains. De nombreux jeunes Australiens ont été attirés par la Grande-Bretagne, et Londres en particulier, au milieu des « swinging sixties ». Pilger devint le correspondant étranger du quotidien Daily Mirror, notamment aux États-Unis.
Comme pour beaucoup de sa génération, la guerre du Vietnam, avec sa criminalité flagrante et son néocolonialisme, a constitué un tournant particulier.
Le premier documentaire de Pilger, The Quiet Mutiny, fut diffusé sur la chaîne britannique ITV en 1970. Il soulignait l’opposition croissante à la guerre parmi les conscrits, ou « râleurs », obligés de participer à la plupart des combats. Le film comprenait des scènes mémorables de jeunes hommes de la classe ouvrière déclarant qu’ils n’avaient aucune envie de tuer des Vietnamiens et qu’ils étaient hostiles au gouvernement américain et à ses commandants.
Que ce documentaire ait remporté sept prix, témoigne de l’esprit qui régnait à l’époque. La réaction des États-Unis fut hostile. Walter Annenberg, l’ambassadeur américain à Londres et ami personnel du président Richard Nixon, déposa une plainte officielle auprès des autorités britanniques de sa radiodiffusion.
Pilger revisite la guerre du Vietnam dans trois autres films. Parmi eux, Vietnam: Still America’s War (1974), qui révélait le caractère bidon des accords de paix de Paris de 1973, les troupes américaines continuant de superviser et de mener des opérations meurtrières un an plus tard, même si nombre d’entre elles avaient été rebaptisées entrepreneurs privés. En 1995, Pilger réalisa Vietnam : The Last Battle (1995), qui mettait en lumière les conséquences des bombardements deux décennies après la fin de la guerre, ainsi que la croissance des inégalités sociales à mesure que le Parti communiste du Vietnam se tournait vers des politiques de libre-marché.
En 1979, Pilger sortit Cambodge: les années zéro, le premier de cinq films examinant les événements dans ce pays. Ce documentaire a mis en lumière les bombardements massifs du Cambodge neutre pendant la guerre du Vietnam, orchestrés par Nixon et son secrétaire d’État Henry Kissinger. Cela a tué des milliers de personnes et créé les conditions permettant aux Khmers rouges, d’inspiration maoïste et basés dans la paysannerie, de prendre le pouvoir avant de vider rapidement les villes du Cambodge et de commettre des massacres.
Tourné après l’invasion du Cambodge par le Vietnam, chassant les Khmers rouges, Cambodge: les années zéro comprenait des scènes choquantes d’enfants mourant littéralement de faim. Dénonçant l’indifférence de la « communauté internationale » face à la catastrophe humanitaire, le film de Pilger révélait également la collaboration continue des États-Unis et d’autres puissances impérialistes avec les Khmers rouges, considérés comme un contrepoids potentiel au Vietnam aligné sur l’Union soviétique.
Dans les années 1980, Pilger faisait également état du financement et de l’armement par les États-Unis d’escadrons de la mort ciblant des mouvements populaires, comme les sandinistes au Nicaragua.
Plus tard, Pilger a interviewé Duane Clarridge, qui, en tant que chef de la division latino-américaine de la CIA de 1981 à 1987, était responsable de bon nombre de ces crimes. Clarridge, interrogé sur ce qui donnait aux États-Unis le droit de renverser les gouvernements sud-américains et de mener des guerres sales, a déclaré sans ambages : « La sécurité nationale […] c’est au monde de s’y habituer, nous n’allons pas tolérer des bêtises ».
Pilger s’est opposé à la première guerre du Golfe et au régime de sanctions paralysantes des États-Unis contre l’Irak dans les années 1990. Il a également condamné l’invasion de 2003. Dans une interview avec un journaliste néo-zélandais, qui circule à nouveau largement sur les réseaux sociaux, Pilger a dénoncé les mensonges sur les armes de destruction massive, repris sans critique par le journaliste.
En 2010, Pilger a produit et réalisé The War You Don’t See (La guerre que vous ne voyez pas). Il a dénoncé les médias officiels pour leur complicité dans les guerres en Irak et en Afghanistan, et a opposé à cela le travail de WikiLeaks et de son éditeur Julian Assange.
Pilger allait devenir l’un des défenseurs les plus constants d’Assange qui se trouve dans le collimateur des États-Unis à cause des révélations de WikiLeaks sur les immenses crimes de guerre et violations des droits de l’homme associés à la « guerre contre le terrorisme » commis par les États-Unis. Pilger condamna la tentative de piéger Assange sur de fausses allégations suédoises d’inconduite sexuelle et leurs calomnies associées contre l’éditeur de WikiLeaks.
C’est l’une des raisons qui expliquent l’isolement croissant de Pilger dans les cercles médiatiques officiels. La plupart de la presse a non seulement répété les mensonges et les calomnies américains contre Assange, mais a développé sa propre propagande contre lui dans une campagne que le rapporteur des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer, qualifierait de « harcèlement collectif ».
Pilger a également écrit sur le rôle des États-Unis et de leurs alliés dans le coup d’État de 2014 en Ukraine, visant à installer un régime pro-OTAN dans le cadre d’une intensification de l’agression contre la Russie. Son documentaire de 2016, The Coming War on China (la guerre à venir contre la Chine), est l’un des rares longs métrages sur cette question cruciale, qui menace l’existence même de l’humanité. Ces positions mettaient en pièces ce qui était colporté dans la presse grand public et ont conduit à la mise sur liste noire de Pilger de la plupart des médias officiels.
Pilger condamnerait le recours croissant à la censure en ligne. En 2018, il a écrit une déclaration en réponse à une campagne lancée par le World Socialist Web Site contre la censure des sites Web de gauche et anti-guerre par Google et d’autres géants de la technologie. Pilger a écrit : « Quelque chose a changé. Même si les médias ont toujours été un vague prolongement du pouvoir du capital, ils sont désormais presque totalement intégrés. La dissidence, autrefois tolérée par les grands médias, a régressé au rang de métaphore clandestine à mesure que le capitalisme libéral évolue vers une forme de dictature des trusts. »
En 2018 et 2019, Pilger a pris la parole lors de rassemblements convoqués par le WSWS et le Parti de l’égalité socialiste (Australie) exigeant la liberté d’Assange et condamnant la complicité des gouvernements australiens dans sa persécution.
Au cours de sa longue carrière, Pilger a réalisé des films sur un certain nombre d’autres sujets, notamment les horribles conditions sociales qui affligent la population aborigène d’Australie et l’oppression des Palestiniens. D’autres ont évoqué le vol des îles Chagos par les Britanniques, la croissance des inégalités sociales et les atteintes aux droits sociaux fondamentaux, notamment le démantèlement du service national de santé britannique.
Les films de Pilger excellaient lorsqu’ils dénonçaient les crimes de l’impérialisme américain et des autres grandes puissances.
Les points faibles de son travail étaient liés à ceux du journalisme bourgeois – y compris du genre de gauche et radical – basé inévitablement sur une approche impressionniste des événements immédiats et une acceptation de facto de l’ordre social dominant.
Certaines de ses œuvres ont été marquées par l’influence de diverses formes de politique radicale sans issue de la classe moyenne, y compris celles qui ont promu Hugo Chavez du Venezuela et d’autres nationalistes bourgeois latino-américains. La soi-disant marée rose sur ce continent s’est terminée par un fiasco, les nationalistes bourgeois de « gauche » mettant en œuvre l’austérité et les attaques contre les droits démocratiques, préparant ainsi le terrain à la croissance de forces ouvertement fascistes.
Les limites de Pilger ont été soulignées par son soutien en 1999 à l’intervention australienne au Timor oriental pour de fausses raisons humanitaires. Pour les tendances de la pseudo-gauche australienne, cette campagne a marqué le début d’une entrée ouverte dans le camp de l’impérialisme, y compris le soutien aux opérations de changement de régime en Libye et en Syrie et à l’actuelle guerre par procuration entre les États-Unis et l’OTAN contre l’Ukraine. Cependant, Pilger a dénoncé ces conflits.
La carrière de Pilger était similaire à celle de plusieurs autres journalistes du même âge, tels que Robert Fisk et Robert Parry. Seymour Hersh est l’un des rares de cette génération à être encore actif. Dans le cadre du journalisme bourgeois, ils ont maintenu un engagement courageux à enquêter, y compris sur les guerres et les crimes des gouvernements.
La disparition de ces personnalités est une mesure de la crise du système capitaliste lui-même. Les élites dirigeantes, qui supervisent des crimes de guerre pires que ceux dénoncés par Pilger et préparent des horreurs encore plus graves, ne peuvent tolérer aucune critique ou révélation, même limitée, au sein des médias officiels.
(Article paru en anglais le 10 janvier 2024)