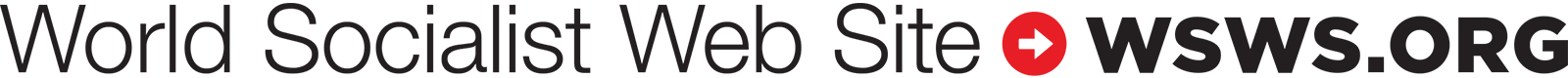La Chine a riposté à l'imposition par l'administration Trump d'un « tarif réciproque » de 34 % en annonçant l'imposition d'un tarif de 34 % sur toutes les importations américaines le 10 avril.
Elle a également pris d'autres mesures contre les États-Unis, notamment une enquête sur une filiale chinoise du géant américain de la chimie DuPont, de nouvelles restrictions sur l'exportation de terres rares et l'ajout d'autres entreprises américaines à sa « liste d'entités », qui interdit aux entreprises chinoises de leur fournir des composants.
La mise en place de droits de douane généralisés sur tous les produits américains était auparavant considérée comme l'option la plus pessimiste, mais l'ampleur de l'attaque est telle que Pékin a décidé de la mettre en œuvre.
Dans une déclaration, le ministère chinois du Commerce a qualifié l'action des États-Unis de « manœuvre d'intimidation unilatérale typique ». Il a déclaré que les droits de douane américains n'étaient « pas conformes aux règles du commerce international » et qu'ils portaient gravement atteinte « aux droits et aux intérêts légitimes de la Chine ».
Avec la hausse de 20 % des droits de douane annoncée avant le « jour de la libération » de Trump mercredi dernier, l'augmentation totale des droits de douane dans la dernière série de mesures s'élève à 54 %.
Mais selon l'Institut Peterson d'économie internationale, ce chiffre est encore plus élevé. Combiné aux mesures tarifaires précédentes, le taux atteint 76 %, soit bien plus que les 60 % que Trump avait laissé entendre auparavant.
Trump a réagi à l'action de la Chine en publiant sur ses réseaux sociaux un message contenant un avertissement implicite de nouvelles mesures américaines à l'encontre de la Chine.
« La Chine a mal réagi », a-t-il déclaré. « Elle a paniqué, ce qu'elle ne peut pas se permettre de faire. »
Ce message doit être lu à la lumière d'une déclaration contenue dans la fiche d'information qui accompagnait le décret annonçant la hausse des droits de douane.
Selon cette fiche, le décret, pris en raison d'une menace pour la « sécurité nationale », contenait une « autorisation de modification, permettant au président Trump d'augmenter les droits de douane en cas de représailles de la part de ses partenaires commerciaux ».
La « justification » officielle des « droits de douane réciproques » est qu'ils visent à compenser les mesures non tarifaires prises par les pays, telles que les taxes, les réglementations et les mesures de biosécurité, considérées comme des obstacles non commerciaux aux produits américains.
Le niveau des droits de douane a été déterminé par un calcul à l'envers. Le déficit commercial des États-Unis avec le pays concerné était divisé par le total de ses exportations afin d'obtenir un pourcentage qui était ensuite divisé par deux pour obtenir le montant du « tarif réciproque ».
Cela a entraîné d'énormes hausses tarifaires pour un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est qui sont devenus d'importants centres de production approvisionnant le marché américain.
Le pays le plus durement touché est le Vietnam, pour lequel le « tarif réciproque » s'élèvera à 46 %. Les droits de douane imposés à Taïwan s'élèvent à 32 % et ceux imposés à la Thaïlande à 37 %.
Ces droits de douane auront un impact majeur sur les économies de la région et pourraient même entraîner certaines d'entre elles dans la récession.
Qu'il s'agisse d'un accident ou d’un plan sciemment calculé (l'explication la plus probable), ils visent indirectement la Chine. À la suite des mesures tarifaires visant la Chine sous la première administration Trump, de nombreuses entreprises, chinoises et américaines notamment, ont déplacé leurs activités en Asie du Sud-Est afin d'esquiver l'impact des droits de douane. Cette voie est désormais fermée.
La presse financière et les milieux d'affaires multiplient les avertissements selon lesquels le monde est en train de plonger dans une guerre commerciale totale, semblable à celle des années 1930, qui a joué un rôle crucial dans l'intensification de la Grande Dépression, et peut-être même plus dommageable que celle-ci.
« Cela ressemble de plus en plus à une véritable guerre commerciale », a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché chez l’important assureur suisse Zurich Insurance Company Ltd., au Financial Times, avertissant que la « politique économique malavisée » de Trump n'avait pas encore été prise en compte par le marché.
Il faisait référence à la croyance largement répandue selon laquelle les mesures ne seraient pas aussi sévères qu'on le pensait et qu'en tout état de cause, elles seraient simplement « transactionnelles », visant à obtenir des concessions au sein du régime existant plutôt qu'à le détruire complètement.
Dans un éditorial publié vendredi, le FT a déclaré que la décision prise par Trump en avril serait considérée comme « l'un des plus grands actes d'automutilation de l'histoire des États-Unis ». Les « droits de douane réciproques », selon l'éditorial, « provoqueraient des dégâts incalculables sur les ménages, les entreprises et les marchés financiers du monde entier, bouleversant un ordre économique mondial dont l'Amérique a bénéficié et qu'elle a contribué à créer ».
Mais ces avertissements sur les effets de ses mesures n'auront aucun impact sur Trump, car il a élaboré un discours selon lequel la Grande Dépression n'aurait pas eu lieu si les droits de douane de l'époque du président William McKinley avaient été maintenus et le régime commercial libéral de l'après-guerre n'a pas profité aux États-Unis, mais leur a nui.
Dans un autre message publié sur les médias sociaux et destiné aux « nombreux investisseurs » qui arrivent aux États-Unis avec des « sommes d'argent considérables », il a déclaré que « ma politique ne changera jamais. C'est le moment idéal pour devenir riche, plus riche qu'avant ».
Ce sentiment ne semble pas être partagé par les marchés financiers. Vendredi, Wall Street a de nouveau fortement chuté. Au cours des deux jours qui ont suivi l'annonce des droits de douane, la capitalisation boursière a chuté de 6,6 billions de dollars, les actions du secteur de la haute technologie entrant dans la catégorie des marchés baissiers avec des baisses supérieures à 20 %.
Les effets se font déjà sentir dans l'économie réelle, un certain nombre d'entreprises annonçant des licenciements en raison des hausses tarifaires et de l'incertitude croissante.
Les prévisions de croissance pour les États-Unis sont revues à la baisse. JP Morgan a revu à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie américaine, passant d'une croissance de 1,3 % en glissement annuel au quatrième trimestre à une contraction de 0,3 %. Le taux de chômage devrait atteindre 5,3 %.
Citigroup a réduit ses prévisions de croissance de 0,6 % à 0,1 %.
L'attaque massive contre la Chine aura des ramifications dans le monde entier, notamment en Europe, qui est déjà sous le coup des « droits de douane réciproques » de 20 % et de la taxe de 25 % sur les voitures importées aux États-Unis.
En réponse, l'Union européenne prépare des mesures tarifaires à l'encontre des produits chinois qui, selon elle, entreront sur le marché après avoir été exclus des États-Unis.
Robin Winkler, économiste en chef de la Deutsche Bank pour l'Allemagne, a déclaré que le choc commercial immédiat subi par l'Asie se répercuterait probablement sur l'Europe, car les fabricants chinois essaieraient de vendre davantage de leurs produits face à « un formidable mur de droits de douane aux États-Unis ».
Selon un diplomate américain de haut rang cité par le FT :
Nous devrons prendre des mesures de sauvegarde pour un plus grand nombre de nos industries. Nous craignons que cela ne devienne un nouveau point de tension avec la Chine.
L'une des mesures envisagées est d'augmenter encore les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, qui s'élèvent actuellement à 35 %.
Une telle réponse – intensifier la guerre tarifaire – est hautement significative sur le plan politique. Elle démontre que la crise dans laquelle est plongée l'économie mondiale n'est pas le résultat de l'irrationalité de Trump. Les guerres tarifaires naissent de la contradiction fondamentale de l'économie mondiale, celle entre la production mondialisée et le système des États-nations, pour laquelle les classes dirigeantes de tous les pays n'ont pas d'autre réponse qu'une guerre de plus en plus profonde de chacun contre tous.
(Article paru en anglais le 5 avril 2025)