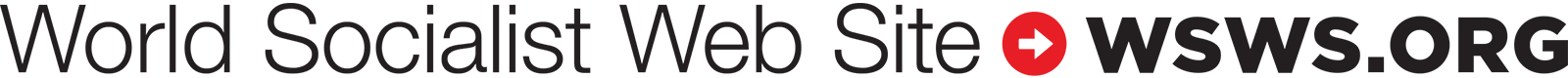Le président américain Trump intensifie sa guerre commerciale contre l'Union européenne en menaçant d'imposer des droits de douane de 200 % sur le champagne et les vins en provenance d'Europe.
Cette menace, annoncée jeudi sur sa plateforme de médias sociaux, fait suite à l'imposition par l'UE de droits de douane de 50 % sur une série de produits, dont le whisky, en représailles aux droits de douane américains de 25 % sur l'acier et l'aluminium.
Qualifiant la décision de l'UE d’«hostile et abusive», Trump a déclaré : «Si ces droits de douane ne sont pas supprimés immédiatement, les États-Unis appliqueront sous peu des droits de douane de 200 % sur tous les vins, champagnes et produits alcoolisés provenant de France et d'autres pays de l'UE.»
Il est peu probable que l'UE fasse marche arrière, car elle a établi un plan de représailles dont la première phase entrera en vigueur le 1er avril.
Elle sera suivie d'une série de mesures dirigées contre les produits agricoles américains qui entreront en vigueur au milieu du mois, ciblant les zones rurales qui constituent la base du soutien de Trump. Le plan a été élaboré dans l'espoir que Trump réagirait comme il l'a fait.
Dans un post sur X jeudi, Laurent Saint-Martin, le ministre français du Commerce extérieur, a déclaré : «Nous ne cèderons pas aux menaces et nous protégerons toujours nos filières». Trump «lance la surenchère dans la guerre commerciale qu’il a choisi de déclencher».
Il n'y a pas non plus de signe d'apaisement de la guerre économique contre le Canada. Après l'envoi d'une délégation à Washington jeudi pour tenter d'apaiser la situation, Trump a déclaré : «Je ne vais pas plier du tout.»
Pour illustrer la manière dont les décisions sont prises au jour le jour à la Maison-Blanche, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a mis en garde les pays contre toute provocation à l’égard de Trump, lors d'une interview accordée jeudi à Bloomberg.
«Si vous le rendez malheureux, il répondra de façon malheureuse», a-t-il déclaré.
Mais il a poursuivi en indiquant au moins la logique sous-jacente de cette folie économique croissante. Certains pays, a-t-il affirmé, comme la Grande-Bretagne et le Mexique, ont réfléchi à leurs relations avec les États-Unis. Quant aux autres, qui ont répondu par des droits de douane, en citant l'UE, «le président va les traiter avec force et puissance».
L'objectif primordial de la guerre économique de Trump est de former un bloc, centré sur l'Amérique du Nord, mais incluant également d'autres pays à condition qu'ils s'inclinent devant les États-Unis, ce qui permettra de s'attaquer à la Chine, que les États-Unis considèrent à plus long terme comme la plus grande menace pour leur hégémonie mondiale. Ceux qui ne s'y plient pas et qui sont également considérés comme des menaces pour les États-Unis, tels que l'UE, seront traités durement.
La guerre des tarifs douaniers menée par Trump sème le chaos dans de larges pans de l'industrie américaine qui ne savent pas ce qui va se passer d'un jour à l'autre, sans parler d'entreprendre une planification à plus long terme. L'objectif déclaré du régime Trump est de forcer les entreprises à localiser leurs activités aux États-Unis.
Mais l'irrationalité économique de cette perspective dans un monde où la production est mondialisée a été mise en évidence dans une lettre adressée par Tesla, la société détenue par Elon Musk, au représentant américain au commerce, Jamieson Greer, au début de la semaine.
La lettre n'a pas été signée car, comme l'a expliqué au Financial Times une personne ayant participé à sa rédaction, «personne dans l'entreprise ne veut être licencié pour l'avoir envoyée».
L'entreprise a déclaré que tout en soutenant le commerce équitable – un clin d'œil à l'affirmation bidon de Trump selon laquelle il rend le système mondial plus juste parce qu’on a profité des États-Unis – elle a averti que les exportateurs américains étaient «exposés à des impacts disproportionnés lorsque d'autres pays réagiront aux actions commerciales des États-Unis».
Soulignant la situation à laquelle est confrontée une myriade d'entreprises américaines, elle a déclaré que «même avec une localisation agressive de la chaîne d'approvisionnement, il est impossible de se procurer certaines pièces et certains composants sur le territoire américain».
Elle a demandé à Greer de «poursuivre l'évaluation des limitations de la chaîne d'approvisionnement nationale afin de s'assurer que les fabricants américains ne sont pas indûment accablés par des actions commerciales qui pourraient entraîner l'imposition de droits de douane prohibitifs sur des composants nécessaires».
Le chaos grandissant dans l'industrie américaine et les craintes que les droits de douane n'entraînent une hausse de l'inflation et une récession commencent à avoir un impact important sur Wall Street.
Jeudi, l'indice S&P 500, l'indicateur principal du marché, a prolongé sa chute et est entré dans ce que l'on appelle le territoire de «correction» : une chute de 10 pour cent depuis son précédent record il y a à peine trois semaines, le 19 février. Au cours de cette période, quelque 5000 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière totale.
Autre signe de l'incertitude croissante, l'or a poursuivi son ascension régulière et a atteint jeudi un nouveau record historique de 2985 dollars l'once, ce qui porte sa hausse totale à 14 % cette année.
La chute du marché a durement touché les actions, l'indice NASDAQ, à forte composante technologique, ayant déjà chuté de plus de 10 %. Le cours de l'action Tesla, l'un des «Sept Magnifiques», a baissé de 40 % depuis le début de l'année.
Les valeurs technologiques ne sont pas les seules à avoir été touchées. L'indice Russell 2000 des petites entreprises a chuté de 18 % depuis son plus haut niveau de novembre dernier et est sur le point d'entrer en territoire baissier (baisse de 20 %).
Auparavant, on a prétendu que la réaction du marché boursier – en l'absence de toute opposition de la part des démocrates, des syndicats et de la complicité des tribunaux – formerait une sorte de «garde-fou» pour freiner le régime Trump, qu'il reculerait d'une partie de sa folie économique si Wall Street commençait à chuter.
Mais jusqu'à présent, l'administration a balayé du revers de la main ce que le New York Times a qualifié de «turbulences du marché». Jeudi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré qu'il se concentrait sur «l'économie réelle» et qu'il n'était pas préoccupé par «un peu de volatilité sur trois semaines».
En fait, l'économie réelle présente un tableau qui s'assombrit rapidement. La confiance des consommateurs est en baisse, les dépenses de consommation ont diminué en termes réels au début de cette année, les enquêtes auprès des entreprises indiquent une chute des nouvelles commandes et les plans d'investissement des entreprises sont suspendus en raison du manque de certitude quant à l'orientation de l'économie réelle. Enfin, les dernières enquêtes sur l'emploi révèlent une forte augmentation des licenciements au cours des deux premiers mois de l'année.
Les estimations de croissance sont revues à la baisse, la Réserve fédérale d'Atlanta avertissant que les États-Unis pourraient connaître une contraction de plus de 2 % au cours du premier trimestre. Goldman Sachs a réduit ses prévisions pour le produit intérieur brut américain de 2,4 % à 1,7 %. Reliant la chute des marchés à l'économie réelle sous-jacente, Kristina Hooper, stratège en chef des marchés à la société de gestion des investissements Invesco, a déclaré au Times : «Je pense que ce que les marchés nous disent, c'est qu'ils sont très préoccupés par la possibilité d'une récession. Ce n'est certainement pas ce à quoi les marchés s'attendaient à l'approche de 2025.»
(Article paru en anglais le 14 mars 2025)