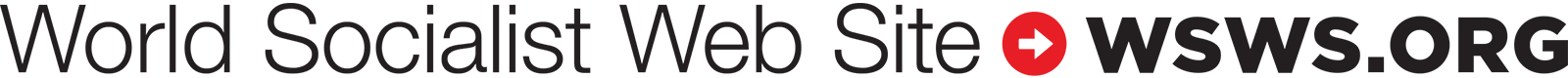L'industrie automobile mondiale est plongée dans la tourmente. Toutes les entreprises, des trusts géants aux plus petites, ignorent l'impact des droits de douane de 25 pour cent imposés par Trump sur les voitures dites « fabriquées à l'étranger ». Elles sont incapables de planifier l'avenir et sont totalement incertaines quant à l'impact qu’auront les hausses de prix causées par ces tarifs sur leurs marchés.
Les géants de l’automobile américains sont parmi les plus touchés, mais toutes les entreprises automobiles du monde sont impactées, avec des conséquences négatives majeures surtout pour les travailleurs américains que Trump, avec le soutien de la bureaucratie syndicale, prétend faussement défendre.
Ils prévoyaient déjà une «restructuration» impliquant des pertes d'emplois massives avant le déclenchement de la guerre tarifaire. À présent, l'attaque des emplois, des conditions de travail et des salaires va s'intensifier, aux États-Unis comme dans le monde entier.
Selon une estimation publiée par le Financial Times, la perte totale pour l'industrie pourrait atteindre 110 milliards de dollars. Dans le système capitaliste, les constructeurs automobiles ne disposent que d'une seule solution pour réagir à un tel choc : réduire massivement leurs effectifs et intensifier l'exploitation de ceux qui restent.
Les effets de la guerre tarifaire et la menace d’une intensification ultérieure, ont déjà entraîné une forte chute des actions boursières de Ford et de GM à Wall Street, celles de GM chutant de plus de 8 pour cent. Les deux entreprises prévoient une chute de 30 pour cent de leurs bénéfices.
Les tarifs douaniers de 25 pour cent imposés au Canada et au Mexique, et maintenant la taxe de 25 pour cent sur les voitures, signifient que les droits de douane sur certaines voitures importées aux États-Unis pourrait augmenter entre 40 et 50 pour cent.
La société de recherche Cox Automotive a prédit que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement complexes qui sillonnent les États-Unis, le Canada et le Mexique pourraient entraîner d'ici la mi-avril une baisse de production de 20 000 véhicules par jour dans les usines américaines, soit une réduction de 30 pour cent.
Les droits de douane seront tout aussi sévères pour les entreprises japonaises, coréennes et allemandes qui exportent des voitures aux États-Unis. Près de la moitié des véhicules de tourisme vendus aux États-Unis en 2024 ont été assemblés hors des États-Unis.
L'année dernière, Toyota a vendu 2,3 millions de véhicules aux États-Unis, dont un quart provenait du Japon et un autre quart du Mexique et du Canada ; la moitié restante étant construite aux États-Unis.
Mais même ces véhicules-là pourraient être impactés par les nouveaux tarifs car une partie, parfois considérable, de leurs composants aura été fabriquée hors des États-Unis, au Canada ou au Mexique. Cette situation s'applique à toutes les autres entreprises, y compris les ‘Trois Grands’ – Ford, GM et Stellantis – qui assemblent leurs produits finis aux États-Unis.
Près de la moitié des véhicules vendus aux États-Unis sont importés et 60 pour cent des pièces utilisées dans les usines automobiles américaines proviennent de l'étranger. À ce stade, on ignore encore où les droits de douane sur ces composants pourraient être appliqués.
Il avait initialement été suggéré que l'administration envisageait d'exempter les pièces conformes à l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), initié par Trump lors de son premier mandat. Mais, comme tant d'autres aspects de la guerre tarifaire menée par Trump, cette position a changé en quelques jours. Les pièces produites dans le cadre de l'AEUMC resteront exemptées de droits de douane jusqu'à ce que le ministère du Commerce «établisse une procédure pour appliquer des droits de douane à leur contenu non américain».
Il est impossible d'évaluer l'ampleur du coup porté à ceux qui étaient autrefois considérés comme les «partenaires commerciaux» des États-Unis mais qui sont aujourd'hui accusés de les avoir «floués» des décennies durant ou qui, dans le cas de l'Union européenne (UE), sont désormais accusés d'avoir été créés pour les «arnaquer». Mais certains chiffres en donnent une idée.
La société financière japonaise Nomura estime que la guerre tarifaire américaine pourrait réduire le PIB du Japon, quatrième économie mondiale, de 0,2 pour cent, soit l'équivalent de 8,78 milliards de dollars. Il s'agit d'un coup dur, car l'économie japonaise ne devrait croître que de 0,5 pour cent cette année, et 40 pour cent de cette croissance limitée sera donc amputé par les droits de douane.
L'impact sur l'UE pourrait être encore plus important. L'industrie automobile représente 7 pour cent de sa production. En Allemagne, où l'automobile est le pilier de son tissu manufacturier, les exportations de véhicules vers les États-Unis représentent environ un demi-point de pourcentage de la valeur ajoutée annuelle de l'économie.
BMW, l'un des principaux constructeurs automobiles allemands, a déclaré qu'il s'attendait à subir une perte d'un milliard d'euros en raison de l'effet combiné des taxes américaines sur le Mexique, des tarifs douaniers américains sur l'acier et des droits de douane européens imposés sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.
Le Canada et l’UE ont tous deux déclaré qu’ils prendraient des mesures de rétorsion contre les États-Unis en imposant des droits de douane sur une série de leurs exportations.
Cela pourrait bien entraîner de nouvelles contre-mesures de la part des États-Unis.
Dans un message publié sur ses réseaux sociaux jeudi, Trump a déclaré: «Si l'Union européenne travaille avec le Canada pour nuire économiquement aux États-Unis, des tarifs douaniers à grande échelle, bien plus importants que ceux actuellement prévus, leur seront imposés à tous deux afin de protéger le meilleur ami que chacun d’eux ait jamais eu!»
L’UE et le Canada pourraient bien répondre qu’avec de tels amis qui a encore besoin d’ennemis?
Ce serait cependant une grave erreur de considérer l’éruption de la guerre économique comme étant la seule œuvre du «maléfique» Donald Trump.
Ses actes ne sont que la manifestation la plus violente d’un processus bien plus vaste: celui de l’effondrement complet des relations économiques et commerciales mises en place après la Seconde Guerre mondiale. Cela précisément pour tenter d’empêcher l’éruption des conflits commerciaux, monétaires et tarifaires qui avaient fortement contribué à créer les conditions pour cette guerre mondiale.
Le recours aux tarifs douaniers par tous les grands pays a augmenté rapidement depuis la crise financière mondiale de 2008. Suite à cette crise, les principales puissances du G20 s’étaient réunies en 2009 à Londres pour s'engager à ne plus jamais recourir aux guerres tarifaires et économiques dévastatrices des années 1930, quelle que soit la gravité de la situation. Et quel est le bilan de tout cela?
Selon Global Trade Alert, une organisation basée en Suisse qui surveille les politiques commerciales, 4 650 restrictions à l'importation sont en vigueur au sein des pays du G2; cela inclut des tarifs douaniers, des quotas, des mesures antidumping et d'autres restrictions commerciales.
Ce chiffre représente une hausse de 75 pour cent depuis le début de la première victoire électorale de Trump en 2016 et près de dix fois le nombre des restrictions en vigueur à la fin de 2008.
Trump accélère assurément ce processus, avec toutes ses conséquences désastreuses mais il n'en est pas la cause fondamentale. Celle-ci réside dans la contradiction inhérente à l'économie mondiale entre le caractère mondial de la production, qu'il s'agisse de voitures ou de toute autre marchandise, et la division du monde en nations rivales et en grandes puissances, sur lesquelles repose le système de profit.
Chacune de ces puissances, États-Unis en tête, cherche à résoudre cette contradiction aux dépens de ses rivales, donnant lieu à une lutte de chacune contre toutes.
Il est désormais largement reconnu dans tous les principaux cercles gouvernementaux, financiers et économiques que l’ordre économique d’après-guerre a disparu et qu’il n’y a aucune perspective de le rétablir.
Après la liquidation de l'URSS en 1991, les idéologues des classes dirigeantes capitalistes ont avancé la thèse de la «fin de l'histoire». Le libre marché, la paix et la démocratie étaient là pour durer.
Mais comme l'a déclaré Neil Shearing, économiste en chef de Capital Economics, dans un commentaire au Wall Street Journal : « Dans les années 1990, le discours était que l'intégration améliorerait la situation de l'Europe et des États-Unis et que les défis mondiaux seraient traités conjointement. Ce discours a disparu. »
Eswar Prasad, économiste à l'Université Cornell et ancien responsable du Fond monétaire international, a fait un commentaire similaire au Journal.
«Nous semblons être au seuil d'une guerre commerciale beaucoup plus vaste, voire totale», a-t-il déclaré. Sur un tel terrain hostile, «c’est chaque pays pour soi».
Cela est vrai dans une certaine mesure. Mais l'enjeu crucial pour la classe ouvrière aux États-Unis et dans le monde entier est d'aller plus loin et d'examiner avec lucidité les implications de cette nouvelle situation. Le principe du chacun pour soi signifie que les gouvernements du monde entier doivent s'armer, se réarmer et se réarmer encore pour pouvoir défendre leur position dans cette lutte acharnée.
En l'absence de toute perspective de réforme, les guerres tarifaires signifient qu'une nouvelle guerre mondiale est en préparation. Pour la classe ouvrière, confrontée à ce danger évident et croissant, la question décisive est de développer sa propre perspective politique indépendante.
Le point de départ pour les travailleurs de chaque pays doit être un rejet et une hostilité implacable au nationalisme de leur «propre» classe dirigeante. Et sur cette base, ils doivent mener une lutte active pour la seule solution à la crise historique du capitalisme qui soit progressiste, c’est à dire l’unification de la classe ouvrière internationale dans la lutte pour le socialisme.
(Article paru en anglais le 29 mars 2023)